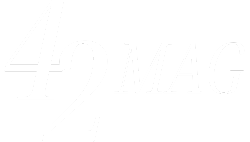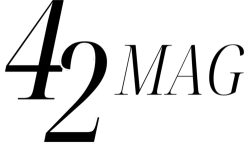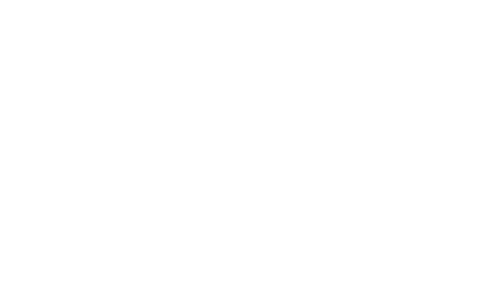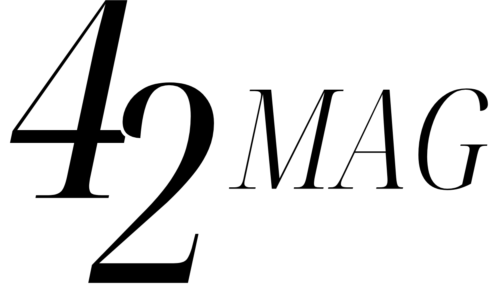Le vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a approuvé les principales dispositions liées à la réforme des retraites.
Créé en 1958 lors de l’établissement de la Cinquième République, le Conseil constitutionnel est aujourd’hui considéré comme une véritable Cour suprême à la française. Au départ, ce conseil avait pour objectif de protéger l’exécutif des ingérences éventuelles des parlementaires qui étaient habitués à exercer leur tout-pouvoir sous la Quatrième République. Les premiers présidents du Conseil, tels que Léon Noël et Gaston Palewski, étaient des gaullistes de longue date. Cependant, le président Giscard d’Estaing a décidé d’élargir la saisine du Conseil à 60 députés ou sénateurs, modifiant ainsi le rôle de cette institution. Dès lors, l’opposition parlementaire pouvait utiliser son droit pour freiner l’évolution du pouvoir.
La création des QPC, évolution majeure en 2008
Le Conseil a par la suite compté dans ses rangs des personnalités illustres, comme Robert Badinter qui y est resté neuf ans. Mais c’est Jean-Louis Debré qui a eu l’influence la plus marquante en transformant profondément le rôle du Conseil, suite à la réforme de 2008 qui a instauré la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Grâce à cette modification initiée par Nicolas Sarkozy, le Conseil contrôle la Cour de cassation et le Conseil d’État. Debré, qui était auparavant magistrat, a mis en place la procédure et a ouvert au public les audiences sur les QPC, tout en préservant le secret des délibérations. Il se montrait déjà critique envers la présence de membres de droit au sein du Conseil, c’est-à-dire les anciens présidents de la République, car il estimait que cette juridiction devait souvent tenir compte des mesures adoptées par un président.
Aujourd’hui, le Conseil constitutionnel se trouve au sommet de la hiérarchie des juridictions françaises et le nombre de ses décisions a été multiplié par près de cent par rapport à ses débuts. Cependant, sa neutralité est parfois mise en doute, car la nomination de ses membres reste de nature politique : ils sont désignés par le président de l’Assemblée nationale, du Sénat et bien sûr par le président de la République. Les magistrats au Conseil constitutionnel sont rares, alors que les cours des autres grandes démocraties, comme les États-Unis, les privilégient. Il faudra sans doute un jour aller dans cette direction pour mettre fin aux soupçons nuisibles de partialité.