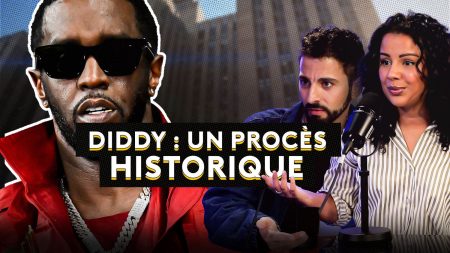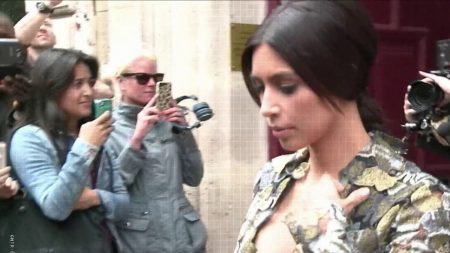Le Conseil constitutionnel est confronté à une demande émanant de critiques du projet d’enfouissement de déchets nucléaires à Bure (Meuse), pour évaluer la possibilité d’intégrer les répercussions à moyen et long terme des actions actuelles dans la législation en vigueur.
Peut-on assurer la sécurité d’un site nucléaire pendant 100, 1 000 voire 10 000 ans ? Cette question est au cœur du débat concernant le site d’enfouissement de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. Des associations militantes écologistes et des habitants locaux s’y opposent et ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester la déclaration d’utilité publique du projet de Centre de stockage géologique (Cigéo). Le Conseil constitutionnel devra rendre sa décision le vendredi 27 octobre.
La question de pouvoir agir au nom des générations futures a été débattue lors de l’audience, il y a quelques semaines. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement de prendre en compte le droit des générations futures ? D’où vient cette notion ?
La préservation des générations futures est mentionnée pour la première fois dans le préambule de la Charte des Nations unies, rédigée en 1945 : « Nous, peuples des Nations unies, sommes résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre ». Cependant, la préservation de ces générations contre les dangers de la destruction de l’environnement, de la disparition de la biodiversité ou encore des émissions de gaz à effet de serre résultant de notre consommation d’énergies fossiles n’y est pas spécifiquement abordée. À partir des années 1970, de plus en plus de militants écologistes ainsi que des juristes ont plaidé pour que le droit intègre la question des conséquences à moyen et long terme des actions menées aujourd’hui.
Dès 1968, des juristes opposés à la guerre du Vietnam ont milité pour la reconnaissance du « crime d’écocide », qu’ils ont utilisé pour dénoncer la dispersion de l’agent orange, un pesticide hautement toxique, sur le territoire. Ils parlaient alors de « guerre contre une terre et des non-nés ». Au niveau international, une mention de cette notion est faite en 1992 dans la définition du « développement durable » donnée par l’ONU lors du sommet de la Terre à Rio. Cette définition précise que le développement durable est « un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Plus récemment, en 2015, l’Accord de Paris a appelé les pays signataires à respecter l’équité entre les générations dans la lutte contre le changement climatique.
Mais à quoi sert concrètement la notion de droits des générations futures ? Selon la magistrate Sonya Djemni-Wagner, « la figure des générations futures, qui s’ajoute à l’action incarnée des jeunes, a l’avantage d’être très évocatrice ». Il s’agit donc de donner une force juridique à cette notion afin qu’elle soit comprise et prise en compte par tous. Cette dimension temporelle supplémentaire qu’elle apporte permet de rappeler que nos actions d’aujourd’hui peuvent avoir des conséquences sur l’avenir.
La France a créé un Conseil pour les droits des générations futures en 1993, par décret présidentiel. François Mitterrand, lors de son discours d’inauguration de cette autorité indépendante, déclarait : « Il serait profondément injuste que nos enfants aient à supporter, en raison de notre aveuglement, le lourd fardeau des sites contaminés, des océans et des rivières pollués ». Cependant, cet organe a été dissous deux ans plus tard suite à la démission de son président, Jacques-Yves Cousteau, en signe de protestation contre la reprise des essais nucléaires dans l’océan Pacifique menée par Jacques Chirac.
Pourtant, en 2001, Jacques Chirac proposait de « définir une éthique collective pour la prise de décision, dans le respect des droits des générations futures », à travers une Charte de l’environnement. Cette charte a été intégrée au corpus constitutionnel français en 2005 et son article 10 précise que « les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». Selon l’avocat Yann Aguila, cette Charte a été cruciale dans l’évolution du droit de l’environnement en France.
Dans une décision datant du 12 août 2022, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs fait référence à cette Charte de l’environnement pour fixer les conditions d’exploitation d’un terminal méthanier flottant dans le port du Havre. Il a estimé que cette exploitation ne pouvait se faire que « dans le cas d’une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz » pour être conforme à la Constitution. Cependant, selon l’avocat Arnaud Gossement, spécialiste du droit de l’environnement, il n’est pas encore question de « droit » ou de « droits » des générations futures, mais plutôt d’une anticipation de leurs besoins.
D’autres pays ont-ils intégré cette notion de droit des générations futures ? Sonya Djemni-Wagner observe que si les générations futures ont encore du mal à trouver leur place dans les institutions démocratiques, elles progressent en revanche dans la jurisprudence, surtout constitutionnelle. Plusieurs pays ont ainsi reconnu constitutionnellement un droit s’appliquant aux individus qui nous succéderont. Par exemple, la Cour suprême colombienne a rendu une décision historique le 5 avril 2018 en reconnaissant que les générations futures étaient des sujets de droit à part entière, en acceptant une plainte de 25 jeunes Colombiens contre des représentants de l’État en Amazonie. En 2021, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne a également montré l’importance que peuvent avoir les générations futures dans le présent en rejetant la loi climat adoptée en 2019. Les juges allemands ont estimé que ce texte n’était pas assez ambitieux compte tenu de l’enjeu. Cependant, il est encore trop tôt pour évaluer l’impact de cette décision, souligne Sonya Djemni-Wagner.