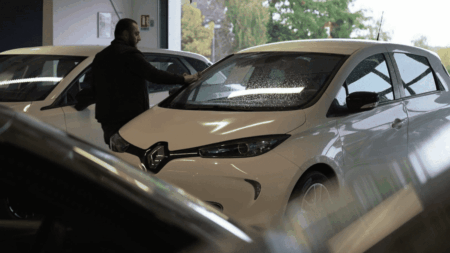L’édile de la capitale française, Anne Hidalgo, initie une enquête de proximité au sujet des frais de garer des SUV dans Paris le 4 février. Ce dispositif qui encourage la participation du public, est en réalité un levier de communication politique très efficace.
« Faudrait-il plus ou moins de SUV dans Paris ?« , cette interpellation a été très présente dans les publicités récentes dans la ville Lumière. L’intention est d’encourager les habitants de Paris à prendre part à une consultation organisée par Anne Hidalgo, la maire socialiste, programmée pour le 4 février suivant. Pourtant, la question posée lors du vote était : « Êtes-vous pour ou contre l’établissement d’un tarif spécifique pour le stationnement des véhicules individuels lourds, encombrants et polluants ? ». Bien que cette question ne coïncide pas exactement avec celle qui sera mise à la consultation, l’orientation de la seconde question semble suggérer la réponse attendue. Cela ne va pas à l’encontre du concept de consultation locale.
Consultation locale par rapport au référendum
Dans le contexte d’un référendum local, une municipalité sollicite de ses citoyens de se prononcer pour ou contre une décision qui sera immédiatement mise en œuvre. Au lieu de prendre une décision en conseil municipal, la ville demande aux résidents de voter. Le vote engage alors l’administration municipale. C’est une forme de démocratie directe.
La consultation locale, en revanche, est distincte puisqu’elle consiste à demander l’avis de la population. La ville n’est pas obligée de mettre en pratique le résultat de la consultation. Il faudra alors un vote en conseil municipal suivant les procédures habituelles. La consultation locale est un moyen de démocratie participative dans le sens qu’elle vise à impliquer les citoyens. Selon Hugo Touzet, sociologue : « La Ville de Paris a déjà ses convictions, comme elle les avait pour les trottinettes. Elle ne le dissimule pas, elle est pour limiter la présence des SUV comme elle était pour interdire les trottinettes. Elle utilise donc cet mécanisme comme un moyen de renforcer son influence politique en affirmant : ‘Nous étions contre, nous avons consulté les Parisiens qui sont également contre, cela renforce notre position.' »
Il précise aussi que le cadre juridique des consultations est plus flexible que celui des référendums : « La loi stipule que les communes choisissent les modalités de leur scrutin, de son organisation. Une commission est mise en place par la ville pour assurer le bon déroulement du scrutin. »
La formulation de la question
Il n’existe aucune exigence en matière de formulation de la question posée. Hugo Touzet met en relief que la question posée par la ville de Paris pour sa consultation sur les SUV est manifestement orientée : « La Ville de Paris applique une politique de diminution de la place de la voiture en général et cette consultation doit être interprétée comme une continuité de cette politique. Cette consultation est un instrument de politique publique à la disposition de la ville. Il s’agit de rechercher l’adhésion et la mobilisation plutôt que la neutralité. »
La manière dont est présentée la question influe sur la réponse de l’interlocuteur, c’est un phénomène largement étudié en sciences sociales : « Si vous demandez à des gens: ‘Êtes-vous pour ou contre la peine de mort ?’ Ou si vous leur demandez : ‘Êtes-vous pour ou contre la peine de mort dans le cas des pédophiles, multirécidivistes, violeurs d’enfants ?’ Vous faites appel à l’émotion des gens et cela influencera les réponses. »
L’effet de désirabilité sociale
Les sciences sociales ont également conceptualisé ce qu’on appelle le biais de désirabilité sociale : « Si la question est formulée de manière à suggérer qu’il y a une réponse positive et une réponse négative, nous avons tendance à vouloir être socialement désirables et à donner la réponse attendue. De même, si nous voulons évaluer le racisme ou l’intolérance dans un sondage, nous ne demanderons pas directement aux gens ‘Êtes-vous raciste ?’ car nous savons que la plupart des gens considéreront qu’il ne faut pas répondre par l’affirmative. »
Qui est consulté ?
Dans les consultations, il est important d’examiner aussi qui est interrogé. Par exemple, lors de la consultation sur les trottinettes à Paris en avril 2023, peu de personnes ont participé. Même si le résultat, qui s’est élevé à 89% en faveur de l’interdiction prévue par la mairie, a été obtenu avec moins de 8% du corps électoral qui a voté. La consultation sur les SUV s’adresse uniquement aux Parisiens inscrits sur les listes électorales alors que l’augmentation des amendes touchera surtout les non-résidents. « Ceux qui pourraient être les plus concernés n’ont même pas le droit de voter, » note le sociologue.
En outre, contrairement aux sondages, les consultations ne sont pas soumises à une obligation de neutralité des personnes interrogées : « Lorsqu’un institut de sondage sonde pour savoir ce que les Français pensent de l’immigration, il a une grande responsabilité sur la neutralité des personnes interrogées pour obtenir des données objectives. Ce n’est pas ce que la Ville de Paris recherche. » L’organisateur d’une consultation locale n’a pas non plus l’obligation de permettre une campagne contradictoire : « Il n’y a aucune obligation de fournir des panneaux d’affichage pour les opposants. »
Hugo Touzet s’interroge sur l’utilité de la consultation en termes de participation : « C’est, à mon avis, un outil peu efficace. Les gens qui sont d’accord ont peu d’intérêt à se rendre voter : s’ils sont d’accord, ils savent déjà que c’est cette réponse qui va gagner, donc ils ne se sentiront pas particulièrement motivés à se déplacer. »