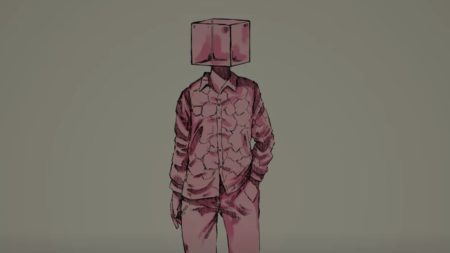Lors de la Journée consacrée à la commémoration des génocides et des crimes contre l’humanité, qui fait aussi mémoire de la libération du camp d’Auschwitz le 27 janvier 1945, France Télévisions diffuse le mardi 30 janvier le film marquant « Shoah » réalisé par Claude Lanzmann. Qu’est-ce qui rend nécessaire le visionnage de cette œuvre épique ? Explication en sept points.
Claude Lanzmann a mis onze ans à produire « Shoah », un film documentaire exhaustif et poignant. Ce film, considéré comme un monument de la mémoire de la tragédie la plus terrifiante du XXe siècle, a été construit à partir d’entretiens avec des survivants, des nazis, et des témoins passifs. Ce film est particulier en ce sens qu’il ne contient aucune image d’archive, ni voix off. Le mardi 30 janvier, le film sera diffusé en intégralité sur France 2.
1« Shoah », le terme hébreu issu du film de Claude Lanzmann
De 1941 à 1945, près de six millions de juifs ont été massacrés par le régime nazi allemand, un phénomène tragique désigné par le terme « La Shoah ». Ce mot, qui signifie en hébreu « la tempête », « le désastre », « la catastrophe », « l’anéantissement », « la destruction absolue », est dénué de toute connotation sacrificielle, à l’inverse du mot « Holocauste » parfois utilisé. D’autres termes, tels que « la destruction des juifs d’Europe » ou « le génocide juif », sont également utilisés pour désigner cet événement. Néanmoins, grâce au film de Claude Lanzmann, « La Shoah » est à présent le terme le plus couramment utilisé.
2« Shoah », l’épitaphe de la tragédie juive
Lors de son passage sur le plateau d’Antenne 2 en 1984, Claude Lanzmann define son film comme étant différent des récits historiques traditionnels, basés sur des souvenirs racontés par des gens assis derrière un bureau. Au lieu de cela, il place des personnes au centre du récit, capables de raviver la réalité tragique de l’holocauste. Il dit : « Les victimes et les bourreaux parlent pour la première fois en 40 ans. J’ai eu plus de mal à trouver les bourreaux que les victimes. » Il décrit son film comme « une fiction du réel », où les personnages racontent leurs propres histoires.
3Qu’est-ce qui rend « Shoah » si unique ?
« Shoah » représente 16 ans de travail acharné pour Lanzmann, entre enquêtes, tournage et montage. Le film a nécessité plus de 300 heures de film en 16 mm et environ une trentaine d’interviews, suivies de cinq ans de montage minutieux. L’un des principes fondamentaux du film est de rejeter l’utilisation d’images d’archives. Comme l’a affirmé Lanzmann, son objectif était de « faire revivre le passé aux protagonistes ». Le philosophe français Simone de Beauvoir a souligné l’importance de « Shoah » dans une lettre à Lanzmann après la première projection du film en 1984, affirmant que cet « édifice monumental » servira aux générations futures à comprendre l’un des moments les plus sombres et énigmatiques de l’histoire humaine.
4Qui sont les témoins dans « Shoah » ?
« Shoah » s’appuie sur plus de 30 témoignages différents. Lanzmann a passé de nombreuses années à rechercher ces témoins et à recueillir leurs récits de l’horreur. Il a interviewé des victimes, des bourreaux et des témoins passifs, comme les Polonais qui vivaient à proximité des camps de concentration et voyaient les trains de déportés arriver. Abraham Bomba, par exemple, était un Sonderkommando à Treblinka, chargé de couper les cheveux des femmes avant qu’elles n’entrent dans les chambres à gaz. Lanzmann l’a interviewé dans un salon de coiffure à Tel-Aviv, alors qu’il coupait les cheveux d’un homme. Abraham Bomba explique, les larmes aux yeux, qu’il était devenu insensible et « mort » à tout sentiment.
5Six nazis témoignent dans « Shoah »
Dans son effort pour documenter la Shoah, Lanzmann a également poursuivi les bourreaux. Six d’entre eux sont interviewés dans le film, soit à la caméra cachée, soit face à la caméra. Certains d’entre eux, a révélé plus tard Lanzmann, ont même été rémunérés pour leurs témoignages. Parmi eux figurent Franz Grassler, adjoint du docteur Heinz Auerswald, commissaire nazi du ghetto de Varsovie, Josef Oberhauser, officier nazi dans le camp d’extermination de Belzec, et Walter Stier, chef du bureau 33 de la Reichsbahn (chemins de fer du Reich).
6Qui est Claude Lanzmann, le réalisateur de « Shoah » ?
Claude Lanzmann est extrêmement présent dans « Shoah ». Sa voix, sa silhouette imposante, son calme et sa persévérance sont au coeur du film. Parfois, la caméra capture son geste discret de réconfort en posant une main sur l’épaule d’un témoin. Il n’y a pas de commentaire ou de voix off ; ce sont plutôt le ton de ses interviews et la présence du réalisateur qui marquent le spectateur. L’engagement de Lanzmann envers le film semble trouver ses origines dans ses propres expériences pendant la guerre. En 1952, il rencontre Sartre et Beauvoir, qui l’encouragent à devenir écrivain et cinéaste. Il vit avec Beauvoir, devient journaliste et rédacteur en chef des Temps modernes et réalise en 1973 son premier film, « Pourquoi Israël ». À la suite de ce film, il se lance dans son grand œuvre, « Shoah ».
7L’opposition ferme à la fiction
Dans une interview accordée au journal Libération en 1987, Claude Lanzmann a déclaré que le recours à la fiction pour raconter la Shoah serait « un crime ». Il a exprimé son rejet de l’idée même de recréer les images des juifs entrant dans les chambres à gaz, déclarant que cela serait « insupportable pour les survivants, les morts, les victimes ». Pour lui, « Shoah » est une expression allégorique du voyage des juifs européens vers la mort. C’est une résurrection. ».