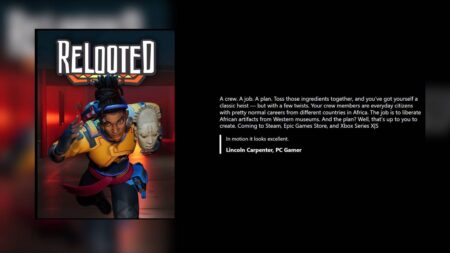Euzhan Palcy, réalisateur français de 66 ans, a la double distinction d’être la première femme noire à diriger un film hollywoodien et la première réalisatrice à gagner un César pour la réalisation. Son portfolio inclut des films remarquables comme « Rue Case-Nègres » (1983) et « Une saison blanche et sèche » (1989), ainsi que plusieurs documentaires. Elle est reconnue aujourd’hui comme étant une pionnière dans son domaine. Le Centre Pompidou à Paris lui rend hommage avec une rétrospective dédiée.
« Je suis facile à repérer, j’ai un manteau de toutes les couleurs », nous confie-t-elle avant notre conversation. Euzhan Palcy, la réalisatrice reconnue, se distingue par sa petite stature dans le hall d’un hôtel parisien raffiné avec un plafond impressionnant. Elle est actuellement au Centre Pompidou à Paris pour finaliser une rétrospective initialement programmée en novembre, mais qui a été interrompue par la grève du personnel du musée. Cette reconnaissance suscite la fierté de la cinéaste, dont le naturel et l’authenticité sont perceptibles tout au long de notre dialogue.
Franceinfo : Vous êtes heureuse de cet événement, nous supposons ?
Euzhan Palcy : Absolument, surtout quand on considère que malgré mes quarante années de carrière, c’est la première rétrospective de ce type en France, mon pays d’origine. J’ai attendu longtemps pour cela. En tant que réalisateurs, nous œuvrons pour que nos travaux soient vus, d’autant plus que nous y consacrons beaucoup d’énergie et de temps. J’ai eu trois événements similaires en Angleterre, ainsi qu’au MoMA à New York dès 2011 et dans d’autres régions des États-Unis et en Afrique du Sud. Mais pas en France…
Vos films ont pourtant rencontré le succès en France : 1,4 million de spectateurs pour Rue Case-Nègres et plus de 520 000 pour Une saison blanche et sèche… Mais sentiez-vous qu’il vous manquait cette reconnaissance du monde institutionnel ?
Recevoir un Oscar d’honneur est significatif, je le dis sans arrogance. Avec Agnès Varda, nous sommes les deux seules réalisatrices françaises à avoir reçu cet honneur (décerné en 2017, ndlr). Je me rappelle que sa réussite avait été justement saluée, alors que pour moi, les réactions de la presse, des décideurs politiques, du ministère de la Culture, ont été décevantes. Pensez à un Teddy Riner ou un Mbappé qui remporteraient un titre mondial sans aucune célébration à leur retour ou même des félicitations ! C’est comme si rien ne s’était passé.
Il y a eu un obstacle raciste en France à votre encontre, d’après vous ?
Oui, bien sûr. À titre d’exemple, mon premier film de long métrage, Rue Case-Nègres, a été difficile à produire, à réaliser et à financer. C’était un véritable défi, malgré tout, j’ai réussi à le réaliser. Un grand studio français m’a dit textuellement : « Ce n’est pas le style de la maison. » À entendre cela… Je ne voulais pas vraiment aller à Los Angeles : mon souhait était de travailler ici, dans mon pays, mais l’opportunité se présentait aux États-Unis. J’ai saisi l’occasion et je ne l’ai jamais regretté. Je ne recherche pas la reconnaissance, je suis une réalisatrice engagée pour rapprocher les cultures, toucher les gens et rétablir la vérité historique, notamment concernant l’histoire des Noirs.
Est-ce que cette situation vous blesse encore ou avez-vous réussi à la surmonter ?
J’ai eu beaucoup de chance de réaliser tout ce que j’ai accompli. Cependant, quand je vois la réaction des Américains, qui ont même demandé « Qu’est-ce qui ne va pas en France ? », cela peut être blessant. J’ai été la première réalisatrice noire à recevoir un Oscar d’honneur et à être produite par Hollywood, c’est très important pour eux. Ils n’ont pas compris pourquoi cette distinction n’a pas reçu plus d’attention en France, et cela a pu me blesser. Parce que je suis française. J’ai tout de même reçu une lettre du président Emmanuel Macron à l’annonce de l’Oscar d’honneur, il écrivait notamment que je contribuais « au rayonnement international de notre pays ». J’étais très touchée, mais rien n’a suivi. Je n’ai jamais obtenu de rendez-vous avec l’ex-ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Cependant, j’ai décidé de laisser ce chapitre derrière moi et je continue sur ma voie, sans amertume ni ressentiment. Il n’y a plus de colère en tout cas.
Cette rétrospective est donc l’opportunité de rétablir votre contact avec le public français et de faire découvrir ou redécouvrir votre travail ?
En effet et d’ailleurs le public me rend bien l’affection que j’éprouve pour lui. Les séances sont complètes, ils ont demandé une nouvelle projection de Rue Case-Nègres. Alors, nous l’avons remis en place, cela me remonte le moral. On m’a dit qu’à Beaubourg, durant une rétrospective, jamais les spectateurs ne se sont levés et n’ont autant acclamé les films. Cependant, beaucoup de personnes me demandent pourquoi ils n’ont pas entendu parler de moi plus tôt.
Vous avez été une pionnière en tant que femme réalisatrice et en tant que femme de couleur ici et à l’étranger. Ces dernières années en France, des réalisatrices comme Maïmouna Doucouré ou Alice Diop, des films comme Un petit frère de Léonor Serraille ou Les miens de Roschdy Zem mettent en scène la vie de personnages ou de familles racisées, mais sans que leur couleur de peau soit le centre du film. Pensez-vous qu’on progresse à ce sujet ?
Oui, et je me réjouis quand je vois ces films. Cela montre que les choses évoluent, certes de manière lente, mais dans une direction positive. On avance à petits pas, mais on avance. Cela reste une lutte et cela prend du temps. Certains de ces projets ont même pris des années à se concrétiser. Mais je suis contente de voir ces jeunes talents émerger et se battre. Je leur souhaite le meilleur et suis prête à leur offrir mon expérience si besoin.