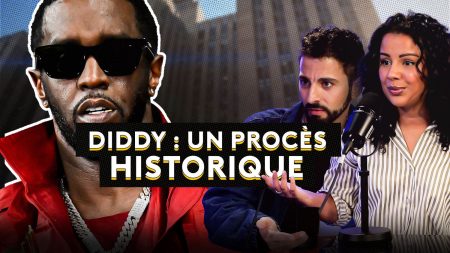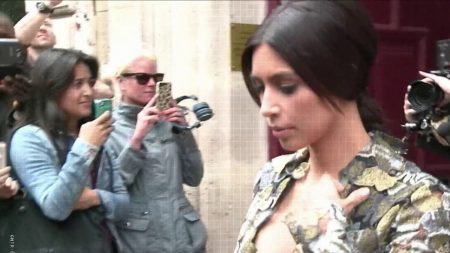Entre 2019 et 2022, il a été observé une diminution significative de 25% du nombre de mineurs impliqués dans des affaires judiciaires. Cependant, il est important de souligner que cette baisse ne reflète pas de manière complète l’évolution de la violence chez les jeunes. En effet, cet indicateur, bien que pertinent, ne prend pas en compte tous les aspects de la délinquance juvénile. Il est donc nécessaire d’approfondir l’analyse en prenant en considération d’autres facteurs tels que la gravité des actes commis, les circonstances sociales des jeunes délinquants, ou encore l’impact des politiques de prévention et de répression mises en place par les autorités. Ainsi, bien que le nombre de mineurs en conflit avec la justice semble diminuer, il est primordial de rester vigilant et de poursuivre les efforts en matière de lutte contre la délinquance juvénile.
Violence chez les mineurs : Analyse de l’enquête sur les assassinats à Grande-Synthe
Les noms de Philippe Coopman, Shemseddine, Samara ont récemment fait la une des journaux, victimes d’agressions, dont deux mortelles, survenues en avril. À noter que la plupart des suspects impliqués dans ces affaires sont des mineurs. Le Président Emmanuel Macron a vivement critiqué « le surgissement de l’ultraviolence » chez des citoyens de plus en plus jeunes. Face à cette montée de la violence, le Premier ministre Gabriel Attal a fait plusieurs annonces à Viry-Châtillon (Essonne) le 18 avril.
Cependant, une question se pose : y a-t-il réellement une hausse des actes de violence commis par des mineurs, comme certains politiques le prétendent ? Le député de La France insoumise (LFI) Manuel Bompard conteste cette idée, citant des chiffres du ministère de la Justice, indiquant une baisse de 25% du nombre de mineurs impliqués dans des affaires judiciaires entre 2019 et 2022.
En évoquant les personnes « mises en cause », Manuel Bompard se réfère à la définition juridique d’individus impliqués dans une affaire en cours d’enquête. Selon le ministère de l’Intérieur, il s’agit de toute personne pour laquelle des éléments graves et concordants attestent de sa participation à des délits ou crimes.
Une baisse significative du nombre de mineurs impliqués dans des affaires judiciaires
Le chiffre mentionné par le député LFI est confirmé dans le bilan statistique du Code de la justice pénale des mineurs, publié par le ministère de la Justice en octobre 2023. En effet, entre 2019 et 2022, le nombre de mineurs mis en cause a diminué de 24%.
Plusieurs hypothèses tentent d’expliquer cette diminution. Certains évoquent l’impact de la pandémie de Covid-19, tandis que d’autres soulignent un processus de ghettoïsation des quartiers pauvres, entraînant une fermeture de ces zones aux institutions judiciaires et policières. Il est ainsi plus difficile de mesurer la violence des mineurs si les habitants ne portent pas plainte.
Pour Nicolas Sallée, sociologue spécialiste du système de justice des mineurs, le nombre de mineurs impliqués dans des affaires judiciaires ne reflète pas nécessairement l’évolution de la violence chez les jeunes. Il souligne que cet indicateur mesure plutôt l’activité des institutions judiciaires que les actes délictueux des mineurs.
Une évolution difficile à évaluer
La réforme du Code de la justice pénale des mineurs, entrée en vigueur en septembre 2021, avait pour objectif d’accélérer les procédures et d’améliorer la prise en charge des mineurs délinquants. Si la violence chez les jeunes avait augmenté, le nombre de mineurs impliqués aurait dû également augmenter, ce qui n’a pas été le cas.
Il est cependant difficile d’évaluer de manière fiable l’évolution globale des mineurs impliqués dans des affaires sur les trente dernières années, comme le souligne un rapport sénatorial. Nicolas Sallée conclut en affirmant que mesurer la violence des mineurs ne se résume pas au nombre de procès ou de mis en cause, et qu’il est nécessaire de distinguer délinquance et violence.
De plus, selon Thomas Sauvadet, la violence des mineurs évolue avec l’essor des réseaux sociaux, qui amplifient et diffusent des actes violents inédits. La transformation des modes d’expression de la violence chez les jeunes est donc un phénomène nouveau à prendre en compte dans l’analyse de la délinquance juvénile.