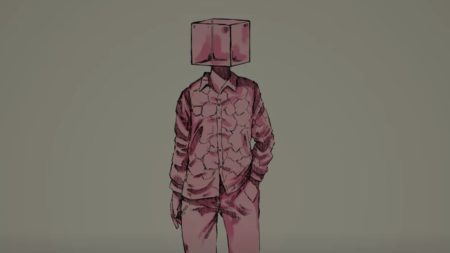Suite au triomphe considérable de « Ma vie de courgette » en 2016, Claude Barras fait un retour remarqué à Cannes lors d’une projection spéciale, en proposant une allégorie écologique et lyrique sur la lutte du peuple Penan face à la déforestation sur l’île de Bornéo. C’est un film d’animation majestueux qui a été conçu en tant qu’incitation à agir.
Alors que le cinéma d’animation est mis à l’honneur chaque année en juin à Annecy, le Festival de Cannes n’a jamais hésité à dédier une belle place à ce type de films. En preuve de cela, une palme d’or d’honneur a été remise cette année à l’incontournable Studio Ghibli, fondé entre autres par Hayao Miyazaki, lequel est à l’origine de grands classiques tels que Le Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro ou encore Princesse Mononoké.
Toujours dans le domaine de l’animation, on peut parler de l’accueil chaleureux réservé à Claude Barras, metteur en scène suisse. En 2016, celui-ci avait déjà présenté à Cannes son film émouvant Ma vie de courgette qui avait rencontré un grand succès au box-office avec plus d’un million de spectateurs. Le film avait également remporté de nombreux prix dont le César du meilleur film d’animation, le cristal du meilleur film et le prix du public au festival d’animation d’Annecy.
Les poupées aux grands yeux étonnés
Déjà, à cette période, Sauvages, était en préparation. 8 ans plus tard, ce film présenté en avant-première à Cannes nous transporte à Bornéo. Kéria, une petite fille de 11 ans qui habite aux abords d’une gigantesque forêt tropicale, tombe un jour sur un bébé orang-outan abandonné dans l’exploitation de palmiers où travaille son père. Parallèlement, Selaï, son jeune cousin, se réfugie chez eux afin d’échapper au différend qui oppose sa famille à des sociétés forestières. Ces deux évènements vont également conduire Kéria aux racines de son histoire, à la découverte de la forêt où se trouve le patrimoine de ses ancêtres, un territoire en péril.
Le dernier film de Claude Barras, véritable appel à la protection des Penan, utilise une fois de plus les petites figurines aux grands yeux ronds qui ont participé au triomphe de Ma vie de courgette. Le réalisateur suisse a de nouveau fait appel à ces personnages atypiques dont la conception demande une année entière de travail. Le tournage, réalisé à Martigny en Suisse, a quant à lui nécessité une équipe de 30 personnes pendant une durée de 7 mois.
Sauvages, comme les précédents films de Claude Barras, est réalisé en stop motion, une méthode exigeant une grande patience. Chaque scène est capturée image par image et, sur chacun des 10 plateaux qui étaient utilisés simultanément, il était en moyenne créé 4 secondes de film par jour.
J’ai expliqué à plusieurs reprises à mon équipe que je considérais ce travail comme une sorte de testament et que je n’avais pas l’intention de réaliser d’autres films après cela. J’ai en effet investi beaucoup d’éléments très personnels dans ce projet. C’est un peu comme une psychanalyse ou une autobiographie masquée.
Claude BarrasMetteur en scène de « Sauvages »
L’action se déroule sur l’île de Bornéo, qui abrite l’une des plus vastes forêts tropicales de la planète, mais l’origine de l’intrigue se trouve dans les souvenirs de jeunesse de Claude Barras. « Je suis issue d’une famille de paysans semi-nomades, explique-t-il. Mes grands-parents pratiquaient la transhumance dans les Alpes, (ndlr, pratique appelée le remuage) nous changions de village en fonction des saisons. Les gens menaient une vie très simple, en étroite relation avec la nature. » Un mode de vie similaire à celui du peuple Penan.
Une ethnie autochtone en voie de disparition
Le réalisateur a fait ce film pour défendre cette ethnie autochtone menacée. Et quoi de plus efficace que le rayonnement international du festival de Cannes pour faire entendre sa cause? Lors de la présentation du film à Cannes, le réalisateur s’est entouré de trois représentants du peuple Penan. Komeok Joe, Nelly Tungang et Sailyvia Paysan ont prêté leurs voix aux personnages de Sauvages.
Komeok Joe est venu de Bornéo pour donner son témoignage sur la déforestation de sa forêt ancestrale tandis que les deux femmes vivent en France. Joe a parlé à la presse de son mode de vie traditionnel, de son enfance passée à suivre ses parents à la chasse et à la pêche, puis de sa vie bouleversée à l’âge de 20 ans, avec l’arrivée des entreprises multinationales et des sociétés d’exploitation forestière. Il se rappelle des traces de bulldozer dans la forêt, des animaux sauvages qui disparaissent et des poissons qui meurent dans les rivières. « Cette forêt est notre source d’oxygène, notre banque, notre supermarché, explique-t-il. Afin de préserver cette réserve unique de biodiversité « et notre mode de vie, nous lutterons jusqu’à notre dernier souffle », ajoute-t-il.