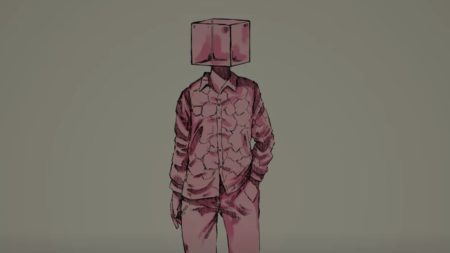« Les Damnés », projeté jeudi en course dans la catégorie Un certain Regard, lors du Festival de Cannes 2024, apporte un éclairage à la fois sur la guerre civile américaine et sur l’époque contemporaine de ce pays.
« Sans spectacle, sans héros, sans gloire », voilà comment est décrit le film, mettant à nu la guerre dans sa réalité la plus primitive. Il retrace le périple d’une unité de l’Union au cours de l’hiver 1862, explorant les contrées encore vierges du Montana.
Ce film, créé par le cinéaste italien Roberto Minervini, met en évidence le désœuvrement et la terreur ressenties par les soldats, qui ne sont parfois encore que des enfants. Il constitue le premier long-métrage de fiction de Minervini qui prolonge ainsi son œuvre documentaire sur l’Amérique.
À découvrir aussi
Festival de Cannes 2024. Roberto Minervini immortalise la guerre, dénuée de gloire ou de héros, dans « Les Damnés », chaleureusement reçu par le public
Peu après la projection de son film jeudi, Roberto Minervini s’est livré à une entrevue avec 42mag.fr Culture pour partager ses impressions sur le Festival de Cannes ainsi que ses motivations à la réalisation de ce premier film radical de guerre, use une narration iconoclaste.
Franceinfo Culture : Pouvez-vous nous dévoiler vos intentions sous-jacentes à la création de ce premier film de fiction ?
Roberto Minervini : Ce film soulève plusieurs questions. D’abord, il est relié au cinéma et aux films de guerre. J’aspirais à réaliser un film qui appartiendrait à un certain genre, tout en remettant en cause certains de ses principes établis. Mon objectif était de renverser ces histoires « machiavéliques » qui confrontent le bien au mal, justifiant la guerre par l’éradication du mal, ces films où une cause juste excuse une fois de plus l’homicide, et qui glorifient l’héroïsme, le martyre et une hypermasculinité toxique. Toutes ces représentations, en réalité, déshumanisent la guerre qui, en vérité, engendre la mort de véritables êtres humains. Ainsi, mon désir était de déconstruire ces représentations, et l’Amérique en particulier, à travers une perspective plus sociologique.
Est-ce une mise en lumière de l’Amérique actuelle ?
Oui, il s’agit d’éclairer la situation actuelle aux États-Unis. Face à une future élection, l’Amérique fait face à de nombreuses incertitudes et ses valeurs semblent devenir moins claires pour ses citoyens. De nombreuses questions se posent. Que va-t-il se passer dans un futur proche ? On observe une pression grandissante pour que le christianisme soit institutionnalisé, y compris dans les écoles. En outre, on assiste à une montée du religieux qui évince les lois républicaines. Cela se révèle en particulier avec ce qui s’est passé concernant les droits des femmes et l’avortement. De surcroît, le système judiciaire, y compris la Cour Suprême, commence à prendre une tournure politique. J’ai donc estimé pertinent de retracer l’histoire des États-Unis, de revenir à ses origines. Comment en est-on arrivé là ? Qu’en est-il de la démocratie, qui semble extrêmement fragile ? J’ai donc voyagé dans le temps pour me pencher sur une période où les gens étaient incertains sur les raisons de leur lutte, sur l’identité de leurs ennemis, et sur leurs valeurs. Je me suis penché sur la guerre de Sécession. Voilà comment tout a commencé.
Des films comme Civil War, mais aussi certains livres, suggèrent une nouvelle guerre civile. Cette préoccupation existe-t-elle aux États-Unis ?
Le 6 janvier 2021 a eu lieu. Une faction de la population a voulu renverser le gouvernement, en attaquant le Capitole, la menace de guerre civile ne relève donc plus de la fiction ou de la « romantisation » des faits. Ce qui s’est passé a créé un choc à travers l’Amérique. Aujourd’hui, les Américains redoutent la division. Le premier mandat de Trump a jeté le discrédit sur les médias, ce qui est défavorable pour la démocratie et peut favoriser l’autoritarisme. De plus, la possibilité d’un retour de Trump au pouvoir existe. Ce sont simplement des faits. C’est la réalité de l’Amérique aujourd’hui.

Je me pose la question