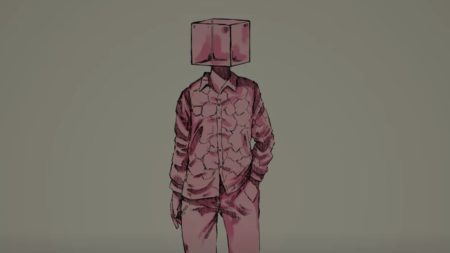Jean-François Laguionie est un participant familier du Festival du film d’animation d’Annecy. Quasiment six décennies après avoir gagné le Grand Prix pour son court-métrage « La Demoiselle et le violoncelliste », il dévoile « Slocum et moi », son septième film de longue durée, dans la compétition principale. Discussion.
Annecy, le 12 juin. « Je dois vous avertir, cela fait huit ans que je ne participe à ce genre d’entretiens. Pendant la réalisation de mon film, je n’ai accordé aucune interview, je suis donc un peu déconnecté du processus ! » nous confie Jean-François Laguionie, installé dans le café d’un hôtel situé non loin du lac d’Annecy. Malgré son avertissement, le réalisateur semble prendre plaisir à l’interview.
À l’âge de 84 ans, récipiendaire de nombreux prix dont la Palme d’or du court-métrage pour son œuvre « La traversée de l’Atlantique à la rame » (1978), Jean-François Laguionie est une personnalité incontournable de l’animation française. Cette année, lors du Festival d’Annecy, il présente son film « Slocum et moi » qui concourt en sélection officielle. Ce dernier est un long-métrage touchant sur l’enfance et la vie familiale. C’est aussi un éloge du voyage et des périples immobiles.
Franceinfo Culture : Dans « Slocum et moi », vous abordez une période de votre jeunesse marquée par un projet de votre père. Pourquoi avez-vous souhaité partager ce souvenir ?
Jean-François Laguionie : La raison précise reste mystérieuse. En réfléchissant à mes nombreuses réalisations, j’ai réalisé que depuis 60 ans, j’ai toujours eu un projet de film en tête ou en cours de production. Je me demandais alors d’où provenaient cette imagination, ces idées, souvent liées à l’océan. Tantôt, je me remémorais les vacances d’été passées au bord de l’eau, mais cela ne me semblait pas être une réponse satisfaisante. Puis, le souvenir d’une période très spéciale de mon enfance a refait surface. Mon père avait entrepris de construire un bateau, réplique de celui du célèbre navigateur Joshua Slocum, bien que nous vivions en banlieue parisienne avec un très petit jardin. Partager ce souvenir était pour moi un moyen d’honorer mes parents tout en faisant la lumière sur une part de mon enfance. Je fus un enfant unique, joyeux et libre, mais aussi plutôt solitaire.
Vous évoquez l’imagination, les souvenirs, quelle part de fiction avez-vous introduite dans « Slocum et moi »?
Aucune ! Le film raconte fidèlement ce que j’ai vécu entre 11 et 16 ans, jusque dans les moindres détails. Je me suis amusé à reconstituer les événements exactement tels qu’ils se sont produits, comme si je créais un documentaire très chronologique de ma propre vie.
En parlant de documentaire, vous reproduisez fidèlement l’atmosphère des années 1950, avec la musique de bal musette, le catalogue Manufrance…
Le catalogue Manufrance est présent dans tous mes films. À cette époque, c’était le livre le plus précieux de la maison. Mes parents ne roulaient pas sur l’or, et les appareils électroménagers américains envahissaient le marché après la Libération… Le catalogue était un livre rempli de rêves.
Dans « Slocum et moi », votre père est surpris par votre talent en dessin. Ce documentaire sur votre enfance raconte-t-il aussi les prémices de votre carrière ?
D’une certaine manière, oui. Le dessin m’a permis de me sentir un peu moins seul, ce qui est un thème important du film. J’avais peu d’amis, nous n’habitions pas dans une grande banlieue où il m’aurait été facile de rejoindre une bande de copains. Il était d’usage que chacun reste dans son pavillon de banlieue, entouré de murs. Pour tuer le temps, j’ai commencé à dessiner. Et lors de la construction du bateau par mon père, j’ai commencé à dessiner des bateaux pour imiter ses plans car je l’admirais beaucoup. Et finalement, je dessine toujours des bateaux.
Les dessins ont-ils été une manière de vous impliquer dans le projet ?
Ils ont été une façon de comprendre le projet, car mon père ne m’avait pas averti de ses intentions. Il avait l’habitude de ne parler à personne. C’était une époque où les enfants n’étaient pas impliqués dans les conversations. Je me souviens qu’on nous disait souvent de ne pas parler à table, de ne pas poser de questions. C’est absurde. Aujourd’hui, la bonne éducation passe par le dialogue avec les enfants, surtout pendant le repas, moment où toute la famille est rassemblée.
François, le personnage qui vous représente dans le film, fait une école d’arts appliqués. C’est là que vous avez découvert l’animation ?
En réalité, c’est grâce à Jacques Colombat, un ami de l’école, que j’ai découvert l’animation. Il était fasciné par le travail de Paul Grimault, qu’il avait rencontré lors d’une conférence. Il l’avait convaincu de le laisser faire un film en papier découpé dans son atelier. Moi, j’aimais écrire des histoires, je désirais créer des décors de théâtre, et il m’a entraîné chez Grimault. C’est là que j’ai réalisé mes trois premiers films. Le fait de dessiner, d’aimer raconter des histoires et d’être fasciné par le cinéma, tout cela conduit naturellement à l’animation. C’est un moyen d’expression d’une richesse inestimable.
Vous avez réalisé ces premiers films en utilisant du papier découpé. Plus de 60 ans plus tard, qu’est-ce qui a changé dans votre processus créatif ?
Pas grand-chose ! Quand j’ai projeté « Slocum et moi » à mes amis, ils ont eu l’impression qu’il s’agissait de mon premier film ! Je n’ai pas vraiment suivi l’évolution technologique. Pour mon précédent film, « Louise en hiver », j’avais fait tous les décors sur papier. Pour « Slocum et moi », j’ai fait une dizaine de gouaches pour définir le style. Je crée aussi un storyboard du film. Je l’appelle mon « animatique sauvage ». C’est un travail que je réalise avec Anik Le Ray, qui est la scénariste de « Slocum et moi » et de nombreux autres films. Ça nous prend un an ou deux. Nous créons le vent, le bruit des mouettes, une musique classique provisoire. Avant le tournage, tout est très artisanal.
Malgré cet aspect artisanal, « Slocum et moi » est tout de même réalisé en animation 3D.
C’est exact, mais je ne connais rien à la 3D ! J’ai plutôt tendance à fuir ce problème. L’animation 3D est réalisée par ma fantastique équipe d’animateurs et de décorateurs. J’ai eu la chance de travailler avec Denis Lambert, un excellent assistant réalisateur, qui se charge de ce que je ne sais pas faire. Je lui dois une fière chandelle.
Êtes-vous impressionné par cette évolution technologique ?
Oui, les jeunes réalisateurs font un travail formidable avec ces techniques extraordinaires. Mais je ne les regarde pas nécessairement. Ces huit dernières années, j’étais totalement absorbé par mon film.
L’autre grande évolution du cinéma d’animation, c’est la place croissante qu’il occupe dans l’industrie cinématographique. Avez-vous l’impression que la perception de l’animation a changé depuis vos débuts ?
Dans ma jeunesse, il ne sortait qu’un ou deux longs-métrages par an. Le Festival d’Annecy ne présentait d’ailleurs que des courts-métrages et n’avait lieu que tous les deux ans. Je pense que l’influence du cinéma japonais nous a beaucoup aidés, nous permettant de sortir de l’époque des Disney pour enfants. L’animation était souvent associée à un public jeune, ce qui me désolait. Je n’avais aucune idée de ce qu’était un film pour enfants. Pour moi, c’était un moyen d’expression artistique et mes histoires étaient destinées aux adultes.
59 ans après avoir remporté le Grand Prix du Festival d’Annecy, votre film est sélectionné en compétition officielle. Est-ce important pour vous ?
Pas du tout, car je ne voulais pas être en compétition. Je n’aime pas cela, je n’ai jamais aimé participer à des compétitions lors de festivals. Par contre, lors de la première projection, j’étais très ému. Il y avait beaucoup de jeunes dans le public, et j’ai pu sentir leur émotion à la fin de la séance. Je ne pensais pas que les jeunes, qui grandissent avec de nouvelles techniques, seraient touchés par ce film très artisanal. C’était un beau moment.