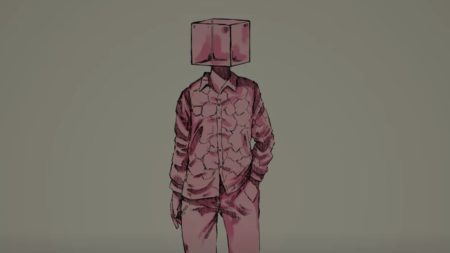L’auteur de cinéma indépendant de 45 ans est de retour avec l’histoire d’un groupe de motards de l’Illinois dans les années 1960. Le charisme et l’attrait du trio composé de Tom Hardy, Austin Butler et Jodie Comer jouent un rôle décisif dans la réussite du film. Entrevue à Paris avec le metteur en scène.
Depuis le mercredi 19 juin, The Bikeriders, le dernier opus de Jeff Nichols, est à l’affiche. Renommé grâce à Loving en 2016, ce réalisateur originaire du Texas s’est fait une place dans le cœur des cinéphiles de par ses œuvres marquantes comme Shotgun Stories, Take Shelter, Mud et Midnight Special. Dans son dernier projet, il a entrepris d’adapter un livre rédigé par le journaliste et photographe Danny Lyon. Celui-ci avait fait la connaissance des Vandals en 1965 et avait ensuite recueilli plusieurs témoignages pour enrichir son travail.
franceinfo : Votre film se concentre sur une période de quatre ans et sur un groupe spécifique, cherchez-vous à explorer une forme de masculinité propre aux États-Unis ?
Jeff Nichols : Oui, mais ce thème dépasse nos frontières. En effet, mes films s’emploient toujours à analyser cette question. L’idée que les hommes, surtout ceux qui proviennent des classes laborieuses, trouvent du mal à exprimer leurs émotions est courante. Toutefois, ce film va bien au-delà de cela. Il se penche sur notre quête d’identité, une des motivations les plus fortes de notre culture actuellement. Tout le monde souhaite se démarquer, être unique, et c’est compréhensible. Cependant, en cherchant tous à trouver notre place dans le monde, nous sommes naturellement entraînés vers des groupes, la foule. C’est dans ces cercles que notre identité se forge, parfois à risques.
Vous donnez la vedette à une bande de « gars », pourtant votre personnage principal, Kathy, interprétée par Jodie Comer, semble être le ciment du film ?
C’est vrai, si vous envisagez ce film uniquement sous un angle masculin, cela peut rapidement devenir monotone et lourd. C’est en grande partie dû au fait que, comme mentionné précédemment, les hommes ont du mal à communiquer leurs sentiments. Qui peut mieux raconter l’histoire alors ? Kathy, en étant au cœur de l’action, est aussi à la recherche de sa place dans le monde. En adoptant son point de vue, nous avons peut-être une chance de comprendre pourquoi les gens autour d’elle agissent ainsi.
Ce récit capture de nombreux aspects de l’Amérique : l’ambition de grandir, réussir, être libre, mais également la précarité, le dénuement, la condition féminine etc. Au-delà du spectacle des belles motos, qu’est-ce qui vous a attiré dans cette histoire ?
Prenez par exemple une moto. Vous la regardez, elle est belle, semble puissante, alors vous avez envie de la conduire, de vous affranchir. L’objet en lui-même évoque une certaine liberté, mais il peut également s’avérer mortel. Cette dualité est fascinante. Les personnages de ce récit m’ont marqué en ce sens, c’est une question qui touche à l’essence même de l’humanité : pourquoi sommes-nous attirés par le danger ? C’est cette interrogation qui forme l’épine dorsale du film. J’ai vraiment trouvé une richesse dans la description du comportement humain dans le livre.
Alors bien sûr, les motos sont magnifiques, les vêtements aussi, mais si on combine les photos de Danny Lyon et les témoignages, on a une réelle étude sociologique. Il a véritablement sondé cette sous-culture, et en tant que narrateur, c’est absolument captivant.
Votre film rappelle par moment des classiques du film de motards comme Easy Rider, Rusty James, L’équipée sauvage… Vous ne vous arrêtez pas là et mettez en lumière le côté sombre (drogue, prostitution, retour difficile du Vietnam). Que cherchez-vous à nous montrer de l’Amérique actuelle ?
Une grande partie de ce que je dépeins est tirée de faits réels : des gangs qui outrepassent les lois, qui se livrent au trafic de drogue, ce qui est à la fois folklorique et contraire à la mentalité des bikers. Mais comment en sommes-nous arrivés là, c’est précisément ce que je veux mettre en lumière. Je ne peux pas affirmer que je commente la situation des jeunes d’aujourd’hui, mais je cherche surtout à interroger cette criminalité institutionnalisée. J’étais intrigué de savoir que tout avait commencé avec seulement deux gars qui voulaient faire de la moto et boire de la bière. Même s’ils étaient enclins à la violence, celle-ci n’était pas structurée, théorisée. C’est cette transition qui m’intéresse.
Sean Baker a décroché la Palme d’Or avec un film indépendant américain. En recevant son prix, il a souligné l’augmentation des difficultés pour réaliser ce type de film aux USA à cause du coût des productions et des budgets compliqués. Vous avez toujours conçu des films personnels, sans grand budget ni grand studio mais avec des stars. Avec Richard Linklater et quelques autres, faites-vous partie des derniers représentants d’une catégorie en danger ?
Étant donné que j’ai 45 ans, j’espère ne pas être sur le point d’expirer (rires). Plus sérieusement, la réalisation de ces films a toujours été un défi. Plus précisément, ce n’est pas tant leur réalisation qui est difficile, c’est plutôt d’attirer l’attention du public. Aujourd’hui, il est encore plus ardu de se faire entendre au milieu du vacarme constant de l’industrie et de tout le contenu qui est diffusé sans arrêt, dans tous les sens. Malheureusement, les plateformes de streaming ne comprennent pas toujours la valeur de notre travail. Elles ont l’impression que la clé est de sortir le contenu le plus rapidement possible, tous les épisodes d’une série en même temps, car c’est ce que les gens veulent.
C’est peut-être ce que les gens veulent, mais pas nécessairement ce dont ils ont besoin. En conséquence, cela a dévalué notre travail. Alors oui, je suppose qu’il a eu du mal à réaliser ses films, mais Florida Project était génial. Quant à moi, je suis dans une position privilégiée, car j’ai un certain niveau de budget grâce à des acteurs qui veulent collaborer avec moi, ce qui est extrêmement précieux. Mais j’ai passé vingt ans de ma vie à réaliser six films.