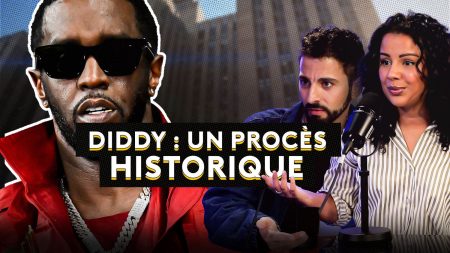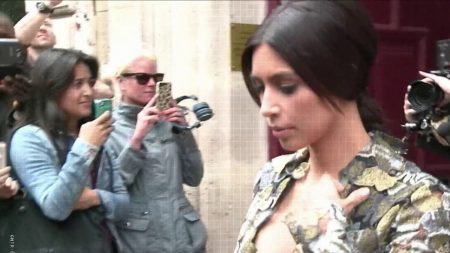Lundi dernier, un incident impliquant une attaque au couteau contre un militaire a conduit à l’arrestation d’un individu. L’enquête s’intéresse actuellement à la possibilité que l’agresseur ait été en état d’abolition de discernement au moment de l’acte. Si cette hypothèse est confirmée par le système judiciaire, l’assaillant pourrait ne pas être tenu responsable pénalement.
Un homme est soupçonné d’avoir blessé au couteau un militaire de l’opération Sentinelle le lundi 15 juillet à Paris. La question se pose désormais de savoir s’il pourrait être déclaré pénalement irresponsable. Dans une affaire précédente en 2018, la justice avait déjà conclu à l’irresponsabilité pénale de cet individu. Après avoir tué un homme de 22 ans à coups de couteau à la station de RER Châtelet-Les Halles, à Paris, il n’avait pas été jugé, conformément à l’article 122-1 du Code pénal, qui stipule que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, au moment des faits, était atteinte d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».
« Le principe, c’est qu’on ne juge pas les personnes souffrant de troubles mentaux graves », résumait en 2021 Didier Rebut, professeur de droit à l’université Paris 2 Panthéon-Assas et spécialiste du droit pénal. C’est pourquoi une personne dont le discernement est aboli ne peut être condamnée, alors qu’une peine réduite peut être prononcée en cas de discernement simplement altéré. Pour prendre leur décision, les magistrats s’appuient sur des expertises médicales mais conservent le pouvoir de décision final. 42mag.fr explique les différentes étapes que suivent les magistrats pour trancher cette question.
Un premier examen médical est réalisé durant la garde à vue
Lors d’une garde à vue, « un examen médical est systématiquement proposé au suspect », assure Valérie Dervieux, magistrate à la cour d’appel de Paris et déléguée régionale du syndicat Unité magistrats. Cet examen a pour but de vérifier que l’état de santé du suspect permet de maintenir la garde à vue. En cas de problème physique ou psychologique, une hospitalisation peut être requise, ce qui peut conduire à suspendre ou lever la garde à vue. Dans le cas du suspect de la gare de l’Est, la garde à vue a été levée mardi pour permettre son transfert à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, selon le parquet de Paris.
L’examen réalisé durant la garde à vue ne vise pas à conclure sur l’irresponsabilité pénale. « Il s’agit uniquement de déterminer des besoins de soins, sans entrer dans une analyse approfondie », précise le psychiatre David Michel, ancien président de la Fédération française de psychiatrie. Il ajoute que cet entretien, souvent « bref », peut être réalisé « par n’importe quel psychiatre de garde à l’hôpital ».
Selon le résultat de cet examen, le procureur de la République peut demander une évaluation psychiatrique pour donner des premiers éléments sur l’irresponsabilité pénale. Si cela suffit à conclure l’affaire, il peut décider de ne pas poursuivre le suspect, et le préfet peut alors prendre des décisions relatives à sa prise en charge psychiatrique. Toutefois, cela ne concerne que les délits; pour les crimes, un juge d’instruction doit obligatoirement être saisi.
Une expertise pour évaluer l’état de discernement du suspect
Si une information judiciaire est ouverte, le rapport réalisé en garde à vue peut jouer un rôle important. Par exemple, dans le cas de l’attaque à la gare de l’Est, le suspect est poursuivi pour « tentative d’assassinat ». Pour les crimes, le juge d’instruction désigne systématiquement un expert psychiatre pour évaluer si la responsabilité du suspect était réduite ou abolie au moment des faits. Toutefois, le psychiatre David Michel admet que « le délai entre l’acte et notre expertise pose un vrai problème technique ».
L’examen médical réalisé durant la garde à vue est donc crucial, car il a lieu très peu de temps après les faits. « Comme il est fait rapidement après l’incident, il peut être très utile », explique Joëlle Palma, experte psychiatre auprès de la cour d’appel de Nîmes (Gard). Cependant, ce n’est pas la seule source d’information : « Si le suspect est hospitalisé, le magistrat peut demander la saisie de son dossier médical », indique-t-elle.
En revanche, si le suspect est incarcéré lors de l’instruction, les psychiatres ne peuvent pas accéder facilement aux informations de l’équipe soignante en prison en raison du secret médical. « Cela complique notre travail », observe David Michel. Dans ce cas, l’évaluation repose sur les déclarations du suspect, compliquant la vérification des antécédents médicaux, de la prise de médicaments, ou de l’utilisation de drogues. « Vérifier toutes ces informations n’est pas toujours possible », souligne Joëlle Palma.
« L’expertise est plus difficile sans accès au dossier : tout repose sur les déclarations du suspect. »
Joëlle Palma, experte psychiatre auprès de la justiceà 42mag.fr
Le juge d’instruction peut solliciter plusieurs expertises psychiatriques selon la complexité du dossier : « Il peut y avoir une première expertise, une contre-expertise, un complément, une contre-contre-expertise… », explique la magistrate Valérie Dervieux. Ces entretiens durent généralement « au minimum une heure », selon David Michel, et visent moins à poser un diagnostic qu’à déterminer si l’acte a été commis lors d’une « crise aiguë ». Un trouble mental ne conduit pas systématiquement à l’abolition du discernement. « Un schizophrène stabilisé avec son traitement est responsable de ses actes », rappelle Joëlle Palma.
Le juge d’instruction décide de l’abandon des poursuites ou de la tenue d’un procès
Une fois les expertises réalisées, le juge d’instruction dispose de plusieurs options. Si les preuves sont suffisantes et que le suspect est jugé responsable, il est renvoyé devant la juridiction compétente : la cour d’assises pour les crimes et le tribunal correctionnel pour les délits.
En revanche, si le discernement est jugé aboli au moment des faits, le juge peut rendre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, stipulant « qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés », selon le Code de procédure pénale. Il s’agit alors d’une ordonnance de non-lieu. Le suspect et les parties civiles peuvent faire appel. Une telle ordonnance est « très rare », selon Valérie Dervieux, car le juge saisit souvent directement la chambre d’instruction.
Un troisième cas de figure existe: la chambre d’instruction doit décider lors d’une audience si le suspect est pénalement responsable. Si elle conclut à l’abolition du discernement, elle rend un arrêt d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, pouvant s’accompagner de mesures de sûreté ou d’une hospitalisation d’office.
Depuis une réforme de 2022, une voie intermédiaire est possible en cas de contradiction entre les expertises: le juge d’instruction renvoie le dossier devant la juridiction compétente (tribunal correctionnel ou cour d’assises) qui doit décider de la responsabilité pénale. Si le suspect est jugé responsable, le procès a lieu, mais le débat sur le discernement continue, et les magistrats doivent trancher lors du procès.
Des contre-expertises peuvent être demandées, notamment aux assises
Avant le procès, les parties peuvent demander des expertises supplémentaires, tant pour les délits (au tribunal correctionnel) que pour les crimes (en cour d’assises). Cependant, « les contre-expertises sont extrêmement rares pour les délits », sauf dans les affaires très médiatisées, explique Benjamin Marty, magistrat au tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), qui souligne « la rareté des experts disponibles actuellement ».
Il est donc fréquent que les juges correctionnels n’aient qu’un seul rapport d’expertise pour se prononcer. « En théorie, nous ne sommes pas tenus d’être d’accord avec ce rapport, mais en pratique, cela arrive rarement », assure Benjamin Marty.
« Si un expert psychiatre conclut à l’abolition du discernement, je ne vais pas le contredire car il est plus compétent que moi sur la question. »
Benjamin Marty, magistratà 42mag.fr
En matière criminelle, plusieurs expertises sont courantes pour évaluer le discernement de l’accusé. Les débats peuvent être vifs. « Le problème survient lorsque certains experts concluent à une ‘altération’ et d’autres à une ‘abolition' », explique le psychiatre David Michel. Si le discernement est « altéré », le suspect est jugé responsable, ouvrant la voie à une condamnation, bien que réduite.
Les jurés peuvent s’appuyer sur la présence d’experts psychiatres durant le procès pour clarifier les points obscurs. « Nous expliquons notre rapport, vulgarisons les termes médicaux techniques », témoigne Joëlle Palma. « La comparution de l’expert permet aussi de poser des questions pour approfondir certains points », ajoute Benjamin Marty. En fin de procès, si le jury conclut à l’abolition du discernement, le suspect est déclaré irresponsable pénalement et n’est pas condamné, mais peut être soumis à une hospitalisation sous contrainte.