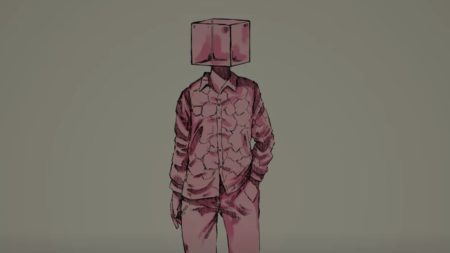Près de cent ans après avoir été filmé, ce long-métrage demeure une innovation avant-gardiste et une œuvre inimitable dans l’histoire du cinéma international. Georges Mourier, à la fois cinéaste et investigateur, nous éclaire sur les raisons de cette singularité.
Après seize ans de travail titanesque, le film Napoléon vu par Abel Gance, initialement sorti en 1927 et ayant subi de multiples modifications et restaurations, a été présenté partiellement le 14 mai dernier à Cannes et est enfin prêt à rencontrer le public du 21e siècle. La version de plus de sept heures, en deux parties, que Georges Mourier, réalisateur et chercheur, a minutieusement reconstruite et restaurée pour la Cinémathèque française, a été projetée en ciné-concert les 4 et 5 juillet à la Seine Musicale. Les orchestres et chœurs de Radio France, dirigés par Frank Strobel, ont accompagné cette projection monumentale, recevant des ovations prolongées après chaque partie.
Le film poursuit désormais sa route dans les cinémas Pathé et dans les salles d’art et d’essai, à la Cinémathèque pour deux week-ends de projection les 13-14 et 20-21 juillet, ainsi qu’au Festival Radio France Montpellier pour deux soirées les 18 et 19 juillet.
Pour les passionnés de cinéma, Napoléon vu par Abel Gance est un chef-d’œuvre indépassable qui illustre la jeunesse de Napoléon de l’école militaire de Brienne à la campagne d’Italie. Ce film était déjà un classique à sa sortie, et il le reste après quatorze années de restauration acharnées menées par Georges Mourier et deux années d’une musique inspirée composée principalement à partir d’œuvres préexistantes par Simon Cloquet-Lafollye. Pour Mourier, qui a exploré en profondeur ce film et l’œuvre d’Abel Gance, tout en étant un connaisseur des incarnations de Bonaparte sur grand écran, Napoléon est bien plus qu’un film restauré ; c’est un rêve inachevé qui témoigne d’une période historique de bouillonnement créatif. 42mag.fr Culture a recueilli l’analyse du restaurateur sur ce phénomène unique.
Une société marquée par la Première Guerre mondiale
« Lorsque Abel Gance se prépare à réaliser son Napoléon, l’humanité vient de traverser pour la première fois une guerre mondiale d’une ampleur inédite. Les grands créateurs de l’époque se disaient : « Nous n’avons pu compter sur rien pour éviter cette boucherie, ni patriotisme, ni nationalisme, ni religion, ni Dieu même. » Gance faisait partie de ceux qui pensaient qu’après l’horreur de 1914-18, il fallait inventer quelque chose de nouveau pour unir les peuples. Sinon, on irait droit vers une autre catastrophe, comme ce fut le cas. Ces créateurs avaient une grande culture littéraire. Ils savaient que des œuvres comme celles de Dante, la Bible, la Torah ou le Coran ont eu un impact durable sur l’humanité. Très tôt, Abel Gance écrivait dans son journal intime Prisme, publié après Napoléon, qu’il fallait que le cinéma, ce nouvel art, trouve un créateur capable d’unifier un message universel et d’avoir un effet fort sur les consciences. Gance n’était pas un idéaliste isolé. Ce qui est assez cynique, c’est qu’à la même époque, Staline comprenait aussi que le cinéma pourrait être un outil de propagande exceptionnel pour une population russe majoritairement analphabète. »
L’impressionnisme au cinéma et un rêve universel
« Il est important de comprendre l’état d’esprit des jeunes créateurs qui ont formé le mouvement impressionniste français dans les années 1920-30. Ils découvraient un nouvel art et espéraient, tout comme certains livres avaient changé la manière de penser humaine, que ce nouvel art pourrait lui aussi influencer les consciences et, idéalement, les élever. Abel Gance voyait le cinéma comme une arme puissante pour élever l’esprit humain. Dans Prisme, il écrivait de manière exaltée : « Créer une nouvelle forme d’art pour faire lever la tête aux hommes, car ils ne regardent plus que le sol où est l’or, le charbon et le cercueil, pour retremper leur courage, stimuler leurs énergies, agrandir leurs prisons et supprimer leurs crépuscules. » Il allait même plus loin en aspirant à « dégager la nouvelle orientation spirituelle que doit prendre le monde à une heure où les indicateurs de Route commencent à lui manquer », construisant un « temple de l’Évangile de l’avenir » avec des colonnes portant les noms de Jésus, Bouddha, Mahomet, Moïse, Krishna et Confucius. Cette exaltation montre bien sa foi inébranlable dans le pouvoir missionnaire de l’art cinématographique. »
Gance hanté – et transcendé – par un deuil personnel
« En règle générale, je n’aime pas réduire la création d’un artiste à sa vie privée. Cependant, un événement personnel a marqué Gance profondément. En 1923, alors qu’il se lance dans Napoléon, il est encore sous le choc de la perte de sa compagne Ida Danis, morte en 1921. Ida est tombée malade lors du premier jour de tournage de La Roue et est décédée le jour même où Gance terminait le premier montage de ce film. Après cela, il part aux États-Unis où il rencontre le réalisateur D.W. Griffith, partageant sa vision du cinéma. Sa fille Clarisse (née de sa troisième épouse, Sylvie) a toujours dit qu’Ida est restée présente dans la vie de Gance jusqu’à sa mort. Ce deuil personnel a confronté Gance à l’invisible, ce mystère de l’absence qu’il a dû transcender. En 1922, un an après la mort d’Ida, Abel Gance épouse la sœur de sa compagne, Marguerite, qui jouera Charlotte Corday dans Napoléon. Ils divorceront en 1931, mais sur une copie de 1926 on peut lire en dédicace : À ma grande morte.
Cette perte l’a poussé à explorer l’invisible. Pour Gance, l’artiste doit rendre visible l’invisible, « faire passer sa nuit en plein jour« , selon les mots de Jean Cocteau. Cela l’a obligé à repousser les limites de tout ce qui avait été fait auparavant. Le tournage de Napoléon évoque une joie de création et une énergie partagée. »
Une admiration pour Napoléon née sur le tard
« Contrairement à ce qu’on pourrait penser, Abel Gance n’a pas commencé son projet Napoléon par une fascination initiale pour le personnage. Au départ, il savait qu’il avait besoin d’un grand succès international pour pouvoir réaliser ses œuvres de cœur comme ses Évangiles de lumière, des films à portée universaliste sur les grands prophètes. À 35 ans, il était un réalisateur reconnu et voyait Napoléon comme un moyen d’affermir sa position. En plongeant dans le projet, il découvre la complexité du personnage et le rôle de Napoléon Bonaparte dans la transmission des idéaux de la Révolution française. Gance était intéressé par l’idée que Bonaparte avait, d’une certaine manière, contribué à changer le monde.
C’est donc l’art qui a poussé Gance à explorer Napoléon plus profondément. Il ne se laisse pas absorber par le sujet, mais s’immerge dans la complexité du personnage dans une époque tumultueuse. Gance trouvait dans Napoléon une résonance avec les « grands initiés » qu’il voulait évoquer dans ses Évangiles de lumière. Comme il l’explique : « Le personnage de Napoléon Bonaparte m’intéressait parce qu’il était un paroxysme dans un moment paroxystique de la grande histoire. » Cette tension a rencontré le génie créatif bouillonnant d’Abel Gance. Il est possible que Napoléon n’ait été qu’un prétexte pour Gance de transmettre directement son énergie artistique interne. »
Un foisonnement de trouvailles cinématographiques
« À sa sortie, le Napoléon d’Abel Gance avait au moins vingt-cinq ans d’avance sur son temps. En 2024, ce film est loin d’être désuet. Il demeure une source d’inspiration pour le cinéma de demain, nous rappelant combien nous exploitions aujourd’hui qu’une infime partie du potentiel cinématographique. Ce film est un véritable jaillissement d’énergie créatrice. C’est comme si les ingénieurs informaticiens avaient découvert internet et exploré de multiples voies avant de se limiter à quelques applications spécifiques. Il ne s’agit pas de copier Gance, mais de s’inspirer de sa créativité bouillonnante pour sortir des normes actuelles du cinéma.
Dans Napoléon, on retrouve des montages alternés et rapides pour traduire la frénésie, comme durant la bataille de boules de neige au début du film. Il y a aussi des scènes symboliques plus lentes et pesantes, comme le regard d’un aigle en surimpression sur le visage de Napoléon, offrant une respiration avant des moments extraordinaires qui suivent. »
Le triptyque en polyvision, morceau de bravoure final
« La polyvision, ou triple écran, est une invention de Gance. Cette séquence de vingt minutes reste unique dans l’histoire du cinéma mondial. Contrairement au Cinérama qui est apparu vingt-cinq ans plus tard et qui se contente d’élargir le champ panoramique avec trois caméras, Gance utilise les trois écrans de façon innovante pour représenter différents espaces-temps, parfois liés par une surimpression de paysage. Ainsi, la caméra transcende la simple réalité pour atteindre le but métaphysique que Gance voulait donner à son cinéma, nous plongeant dans l’abstrait. Une autre scène, celle des ombres de la Révolution, connecte le spectateur à l’invisible. Gance voulait abolir les barrières du temps et de l’espace, nous entraînant ainsi dans l’intangible. »
Une œuvre inachevée, un grand gâchis
« Abel Gance avait des œuvres précises en tête comme ses Évangiles de lumière. Mais seul La Fin du monde (1931), sorti après Napoléon, donne une vague idée de ses ambitions universalistes. L’échec du film, coïncidant avec l’avènement du cinéma parlant et la crise de 1929, a ruiné les ambitions de Gance. Le film, initialement prévu avec des séquences en polyvision, fut mutilé pour ne durer plus que 90 minutes, ternissant la réputation du cinéaste. Il ne retrouvera jamais les moyens d’exprimer son œuvre universelle. Pierre Mondy, qui joua Napoléon dans Austerlitz (1960), m’a dit : « Je l’écoutais parler et je suis sûr maintenant qu’il n’a dû réaliser que 5 à 10 % de ses rêves. »
On a souvent qualifié Gance de mégalomane. En réalité, il se voyait comme missionné pour révéler tout le potentiel de l’art cinématographique. Jusqu’à la fin de sa vie, il a gardé cet idéal. Un mois avant sa mort, il travaillait encore sur un court-métrage avec Claude Lafaye : Ainsi parlait Zarathoustra. Sa plus grande souffrance remonte à 1947, quand il lança La Divine Tragédie. Ce projet, prévu comme le pendant parlant de Napoléon, s’intéressait à l’humanité qui détenait pour la première fois de son histoire le pouvoir de s’autodétruire. Vers qui se tourner ? Tel était le sujet. Gance perdit cinq ans de sa vie sur ce projet, aboutissant à un scandale financier et amenant la production à s’effondrer. »
La restauration du Napoléon, du « cousu main »
« En 2008, chargé d’une simple expertise, j’ouvrais les premières boîtes de bobines, sachant déjà que les outils nécessaires à la restauration n’existaient pas. Le Nicroscan, un appareil spécifique de numérisation développé par les laboratoires Éclair, n’était pas encore opérationnel. Certains outils numériques devaient être créés par les techniciens.
Un autre aspect crucial était la colorimétrie. Trois ingénieurs Recherche & Développement ont travaillé pendant trois ans pour restituer les nuances de gris des pellicules d’époque. Ces outils numériques étaient spécifiques au cas du Napoléon, et chacune des 600 000 images a été restaurée minutieusement, comme une dentelle de Delft. »

★★★★★