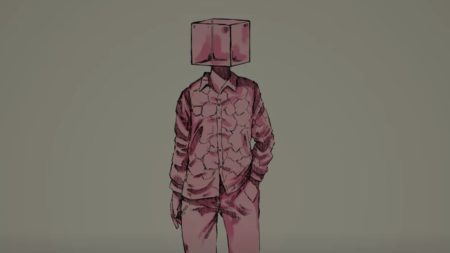Sorj Chalandon a partagé avec 42mag.fr son émoi devant le film qu’il a visionné à de nombreuses reprises. Il est touché de retrouver à l’écran ce qu’il a personnellement vécu dans le camp de Sabra et Chatila au Liban, à l’époque où il exerçait en tant que journaliste de guerre.
Une plongée cinématographique dans les conflits du Liban
Mercredi 15 janvier marque l’arrivée dans les cinémas de l’adaptation cinématographique de Le Quatrième Mur, un roman de Sorj Chalandon couronné du prix Goncourt des lycéens en 2013. Cette œuvre nous emporte au cœur de la guerre du Liban, au début des années 1980. Le film relate le périple de Georges, incarné par Laurent Lafitte, qui se rend à Beyrouth dans le but d’y monter Antigone de Jean Anouilh. Cette mise en scène se déroule en plein milieu des conflits, sur la ligne de front, avec des acteurs venant de toutes les factions en guerre au Liban. Chalandon a imaginé cette histoire après avoir rapporté les événements de Sabra et Chatila en tant que correspondant de guerre.
Retour personnel sur une expérience vécue
Avec un col roulé noir sous une veste grise, Chalandon confie à 42mag.fr Culture qu’il a retrouvé à l’écran des moments de sa vie d’il y a plus de quatre décennies, moments encore plus vibrants avec la résurgence récente des hostilités au Liban.
Quel a été votre ressenti en découvrant le film pour la première fois ?
J’ai fondu en larmes. Je me suis retrouvé projeté à Beyrouth, à Sabra et Chatila. C’était un écho bouleversant. Dès le début, en écrivant ce livre, mon souhait était de redonner vie à une jeune femme que j’avais vue sans vie, et ici, dans le film, elle se relève. Même si on l’écrit dans un roman, l’image de cette femme martyrisée reste gravée. Pourtant, sur l’écran, elle semble si vivante, chantant, dansant, récitant du Darwich.
Participation à l’adaptation
Quelle a été votre implication dans le film ?
Aucune. Je n’entends pas m’immiscer dans les adaptations de mes écrits, que ce soit pour le théâtre ou la bande dessinée. Plusieurs sont en projet, et je préfère rester à distance. Mon rôle est d’écrire des livres ; si d’autres souhaitent les adapter, c’est leur projet, pas le mien.
Modifications dans le scénario
Le film ne reprend pas la première partie du livre, cela vous dérange-t-il ?
Pas du tout. Dans le roman, on démarre à Paris avant de se rendre au Liban. J’avais structuré ainsi pour illustrer l’origine de la violence de Georges, sa filiation, ses engagements militants, une manière de tourner la page sur mes propres années militantes. Mais le réalisateur a choisi de se concentrer sur le Liban, ce qui me semble merveilleux.
Le personnage de Georges à l’écran
Quelle impression cela vous fait-il de voir Georges, ce double de vous-même, incarné par Laurent Lafitte ?
J’apprécie beaucoup cela. J’aime sa transformation en Georges, bien qu’il ne ressemble pas à moi. Le réalisateur David Oelhoffen a façonné un Georges plus sobre, moins radical que moi. Sur l’écran, j’ai retrouvé un personnage d’une sérénité presque enviable, tout en conservant mes mots à travers lui à Beyrouth.
Une retranscription fidèle de votre vécu
Quelle est votre réaction en voyant votre œuvre prendre vie au cinéma ?
Je n’ai pas inventé Sabra et Chatila, je l’ai vécu. Le film m’y ramène. Si c’était une fiction, j’aurais pu être en désaccord avec l’illustration, mais ici, le réalisme est saisissant. Beyrouth est authentique, tout comme Georges, légèrement plus séduisant et apaisé que dans mes souvenirs.
Réminiscences des horreurs de la guerre
La représentation des événements est-elle fidèle à votre expérience ?
Le film restitue à merveille l’ambiance du camp, le son des fusées éclairantes. Le silence assourdissant est capturé à la perfection. Je n’ai pas questionné le réalisateur sur ce point, mais peu importe. L’essentiel est là : une illustration précise de Sabra et Chatila, loin d’être obscène, mais respectueuse et humaine.
Réflexions au temps de la reprise des hostilités
La sortie du film coïncide avec la recrudescence de la violence au Liban, que pensez-vous de ce lien ?
C’est un retour tragique vers le passé. La guerre nous rattrape inlassablement, avec les mêmes acteurs qu’en 1982. Je ressens cela comme un rappel brutal de l’histoire.
Écrire dans la tourmente
Pourriez-vous écrire ce livre dans le climat actuel ?
Il m’aurait été impossible d’écrire ce livre en temps de guerre active. J’avais besoin de la paix pour revivre et narrer le chaos. Aujourd’hui, je refuse de mêler actualité et littérature. La guerre ne doit pas parasiter mes récits.
Un rêve d’humanité au milieu des conflits
Est-il réaliste de continuer à rêver à une réconciliation possible à travers des projets similaires ?
Rêver est toujours envisageable, même nécessaire, malgré la rapidité destructrice des conflits. Les rêves peuvent apporter des instants de paix, même fugitifs, suspendant brièvement la folie de la guerre.
Symboles de paix dans l’art
Le film peut-il être vu comme une victoire de la paix ?
Absolument. Ce film, fruit de collaborations entre des acteurs de différentes factions, démontre que Georges a abouti son projet. Entre deux vagues de violence, un groupe de personnes a pu se rassembler pour créer quelque chose de beau. C’est une véritable réussite.
Georges, un succès inattendu
Le film a-t-il réalisé ce que Georges n’avait pu faire ?
Oui. Finalement, ce que Georges n’a pu accomplir dans l’histoire originale a pris forme à l’écran. Ce succès soudain est émouvant, symbolisant une réussite tardive mais tangible, à laquelle je suis fier d’être associé, par-delà les larmes que je ne peux contenir. Et j’ajoute, pas de pop-corn pour ce film, par respect pour son intensité.