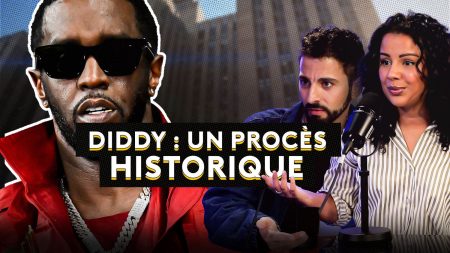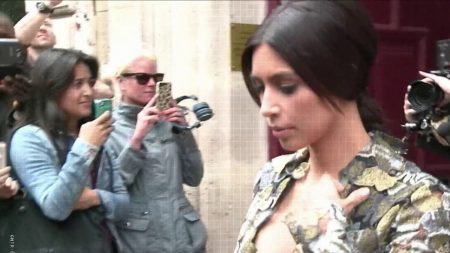Le rapport final publié mardi indique que la nouvelle définition doit clarifier que le consentement doit être explicite, volontaire et révocable à tout moment.
Proposition de changement législatif en matière de viol et d’agressions sexuelles
En 2023, une mission parlementaire a été lancée pour revoir la définition légale du viol et des agressions sexuelles en France. Le rapport final, rendu public le 21 janvier par les députées Véronique Riotton et Marie-Charlotte Garin, propose d’intégrer la notion de « non-consentement » dans la législation. Ce rapport, consulté par 42mag.fr, indique qu’ »il est primordial que l’absence de consentement distingue clairement entre la sexualité et la violence. Une nouvelle définition devrait préciser que le consentement doit être explicite, donné sans contrainte et rétractable à tout moment ».
Les député.e.s suggèrent de préserver et de renforcer les quatre critères actuels de définition, à savoir la violence, la menace, la contrainte et la surprise, afin de conserver l’approche existante en jurisprudence. En outre, le texte propose d’évaluer l’absence de consentement selon les circonstances entourant l’incident, afin d’éviter de centrer l’enquête seulement sur la plaignante et d’empêcher que la notion de consentement ne soit utilisée à son encontre, en particulier pour les victimes vulnérables ou face aux stratégies de certains agresseurs. Cela impliquerait une attention accrue sur le comportement de l’accusé et une évaluation du consentement en tenant compte des vulnérabilités de la victime.
En dernier lieu, le rapport recommande de clarifier les situations où le consentement ne peut être présumé, notamment si la victime n’est pas en capacité de refuser ou lorsque sa vulnérabilité est exploitée.
« La criminalité sexuelle demeure un problème majeur »
Pour justifier la nécessité de cette révision législative, les députées expliquent que « malgré certaines avancées, la criminalité sexuelle ne diminue pas » et qu’un climat d’impunité continue de régner. Selon le rapport, toutes les deux minutes, une personne est victime de violences sexuelles, mais huit victimes sur dix, en dehors du cadre familial, ne portent pas plainte. Les victimes « se retiennent » de déposer plainte, et même lorsque cela aboutit, 73% des affaires concernant des violences sexuelles en 2018 ont été classées sans suite par le ministère de la Justice, alors que l’auteur est souvent identifié. « Le fait que les auteurs ne soient pas largement condamnés perpétue ce climat d’impunité, avec seulement 1 206 condamnations pour viol en 2022 », souligne le rapport.
« L’instrumentalisation du consentement par les auteurs »
Les parlementaires estiment que la loi actuelle ne précise pas suffisamment la notion de « consentement ». Faute de définition claire, ce concept est souvent manipulé par les agresseurs avec des rationalisations telles que « Je ne savais pas » ou « Elle ne s’est pas opposée », renforçant ainsi les stéréotypes sur le viol et compliquant les dépôts de plainte, ce qui entraîne de nombreux classements sans suite au détriment des victimes. Près de dix ans après la montée du mouvement #Metoo et tel que mis en lumière par le procès dit « de Mazan », le rapport insiste sur le fait que combattre la culture du viol est impératif, nécessitant une législation plus explicite.
L’alignement sur les « engagements internationaux » pris par la France est mis en avant comme une motivation supplémentaire pour modifier la définition légale du viol, notamment pour se conformer à la Convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, qui stipule clairement que l’absence de consentement doit être évaluée à la lumière des circonstances entourant l’acte.
Renforcer les mesures pour combattre la culture du viol
En conclusion, la mission parlementaire reconnaît que « la simple modification de la loi ne suffira pas à résoudre tous les problèmes rencontrés par les victimes de violences sexuelles, lesquels sont nombreux et complexes ». Toutefois, cette modification pourrait constituer une étape significative vers le changement structurel attendu par les associations féministes, les professionnels impliqués, et une grande partie de l’opinion publique.
Pour être véritablement effective, cette réforme doit être soutenue par des ressources supplémentaires à chaque échelon du système judiciaire et par une lutte déterminée contre la culture du viol. Il est essentiel que l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle soit disponible partout en France, jouant ainsi un rôle crucial. Le rapport conclut que la réforme doit permettre au droit pénal de mieux exercer ses rôles répressif, protecteur et pédagogique, avec pour objectifs de « mieux prévenir », « mieux reconnaître » et « mieux sanctionner » les viols et les agressions sexuelles.