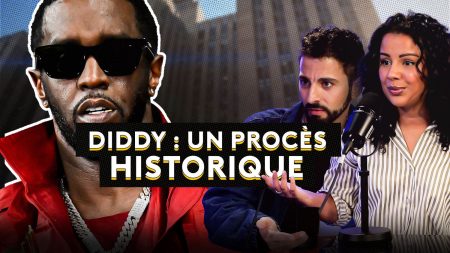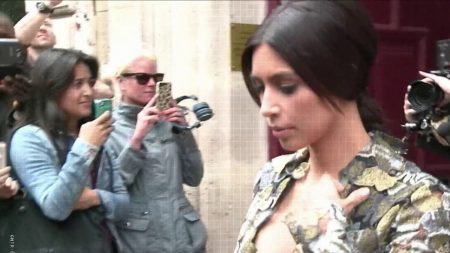En avril 2024, cet homme d’une cinquantaine d’années avait été arrêté pour ne pas avoir obéi aux injonctions et pour avoir exercé des violences envers les forces de l’ordre. Lors de son procès, il s’est montré fermé à toute remise en question et a exposé ses théories complotistes. Finalement, le tribunal lui a infligé une peine de cinq mois de prison avec sursis.
« Je récuse ce tribunal, s’il vous plaît. » Pierre Lecomte parle avec l’aplomb de quelqu’un qui croit profondément en ses convictions. Cependant, ses déclarations dépourvues de fondements juridiques n’influencent pas la juge comme il l’aurait espéré. Ce fut également le cas face aux gendarmes le 1er avril 2024, quand il a affirmé qu’il « ne contracte pas » en guise de réponse à un contrôle routier à Esquelbecq, dans le Nord. Un an plus tard, Pierre Lecomte se retrouve devant le tribunal de Dunkerque, le 1er avril 2025. « Une date symbolique si on est un peu dans l’ésotérisme et les soins naturels », sourit-il après sa condamnation. Cet homme coiffé d’un chapeau de cow-boy et vêtu d’une veste en jean a été condamné à cinq mois de prison avec sursis pour refus d’obtempérer et violences volontaires sans incapacité sur un gendarme.
Présent au tribunal et se défendant sans avocat, cet autoentrepreneur modifie les règles dès le départ. Il ne répond pas au nom de « Monsieur Lecomte », mais préfère être appelé Pierre, Jean-Paul, Patrick, se présentant comme le « seul mandataire exclusif exécutif » du nom Lecomte. Des expressions typiques d’une mouvance complotiste fortement inspirée des idées des « êtres vivants » ou « citoyens souverains », un courant qu’il a découvert durant la crise sanitaire liée au Covid-19, notamment sur Internet. Cette idéologie soutient que, en raison de défauts juridiques et d’une fraude mondiale, l’État français est en réalité une entreprise privée, dépourvue d’autorité légale. Pour ceux qui partagent ces croyances, tout repose sur le fait de choisir les mots justes pour refuser les demandes des autorités.
« Nous ne devons pas nous ‘soumettre’ à quoi que ce soit »
Le terme « se soumettre » irrite particulièrement le quinquagénaire, sans emploi depuis un an. « Ce n’est pas parce qu’on porte un uniforme qu’on peut exiger que quelqu’un se soumette », dit-il avec assurance. La juge le corrige immédiatement : « En réalité, si, Monsieur. » Une réponse à laquelle Pierre rétorque que si les gendarmes lui avaient demandé de souffler dans l’alcootest, il se serait plié à cette demande. Souhaitant changer de carrière vers les soins naturels avec sa compagne, ex-infirmière libérale suspendue pour ne pas s’être fait vacciner contre le Covid-19, il déclare : « Personne ne devrait se ‘soumettre’ à quoi que ce soit, même pas à la loi », ajoutant que le contraire s’apparenterait à « l’esclavage ».
Son discours est truffé de références légales souvent mal interprétées. Il aborde des détails techniques, contestant par exemple le Code de la route, qu’il dit avoir été « signé par Charles de Gaulle » alors qu’il n’était « pas en exercice mais juste élu » selon lui. Il tire également des conclusions hâtives : « Emmanuel Macron a déclaré [durant la pandémie de Covid-19] que les irresponsables ne sont pas des citoyens, donc j’ai perdu ma nationalité. » Pour lui, la Constitution française ainsi que toutes les lois associées sont invalides en raison de la présence de la procureure dans la salle, ce qui, selon lui, violerait la séparation des pouvoirs garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il évoque fréquemment son intention de « porter plainte avec constitution de partie civile ».
« Vous fixez les règles ? »
La juge se démène avec difficulté, essayant à plusieurs reprises de recentrer le prévenu sur les faits reprochés : conduite sans assurance, refus de se soumettre à un éthylotest, et avoir mis le véhicule en marche avant et arrière alors qu’il était encerclé par des gendarmes. Elle s’efforce également de lui expliquer le principe de l’assurance : « Vous vivez parmi nous, parmi d’autres citoyens français, et par conséquent, vous êtes soumis aux mêmes règles qu’eux. Vous empruntez des routes utilisées par d’autres qui ont droit à leur sécurité. C’est vous qui définissez les règles ? Quelle est la limite ? »
Le prévenu admet certains actes, mais reste inflexible face aux critiques globales. Il affirme qu’il n’a pas saisi le bras du gendarme mais l’a simplement « accompagné vers la sortie ». Concernant la marche avant et arrière, il invoque la légitime défense : « J’ai eu peur, le gendarme était armé. Dans ces moments-là, on veut juste se mettre en sécurité. Ils auraient dû me remettre une convocation plus tard. » Pour ce qui est du défaut d’assurance, il mentionne les difficultés financières de son couple depuis les restrictions sanitaires : « J’ai été licencié de manière abusive, nous n’avions plus de ressources, nous ne pouvions plus payer les assurances. » « Mais deux jours après le contrôle, vous avez réussi à obtenir une assurance, Monsieur ! », rétorque la juge.
« Je m’attendais à cette condamnation »
La conclusion du procès ne surprend pas Pierre Lecomte. Reconnu coupable de quatre des cinq délits pour lesquels il était inculpé (il a été acquitté pour le défaut d’assurance car le véhicule lors de l’arrestation appartenait à sa femme), il est condamné à cinq mois de prison avec sursis, soit la moitié de ce qu’avait requis la procureure de Dunkerque, qui n’a pas requis de peine plus lourde en raison de l’absence d’antécédents judiciaires. Pierre Lecomte se voit également infliger une peine d’inéligibilité de deux ans, ainsi que 500 euros de dommages pour préjudice moral envers le gendarme initiateur du contrôle.
Après le verdict, Pierre Lecomte, fidèle à son habitude de provocation, ne se montre pas contrarié. Il affirme aux médias qu’il était préparé à être condamné, une éventualité qu’il avait ouvertement anticipée sur les réseaux sociaux avant l’audience en clamant que selon ses critères, il avait déjà « gagné ». Prétendant reconnaître uniquement l’autorité d’une « Cour Internationale de Droit Commun » (qui n’a aucune existence légale), il ne compte pas faire appel de la décision, mais prévoit de porter sa propre plainte jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme et de saisir la Cour pénale internationale.