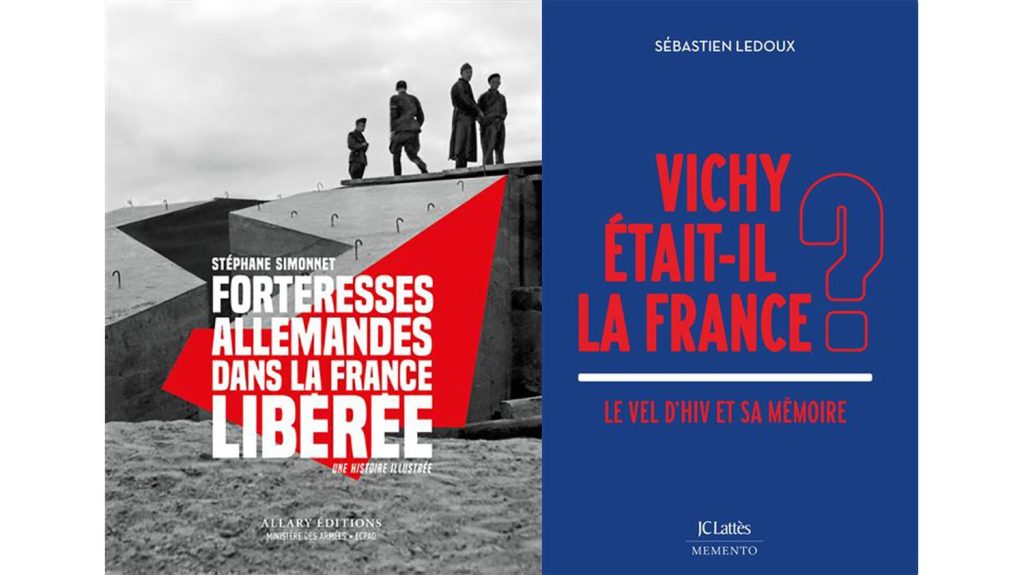En ce week-end du 8 mai, explorons l’histoire peu connue des « Poches de l’Atlantique » ainsi que l’évolution de la mémoire liée à la Rafle du Vel d’Hiv.
Alors que l’on commémorait cette semaine les 80 ans de la reddition de l’Allemagne, voici un livre qui met en lumière une facette souvent négligée de l’histoire : celle des villes françaises non encore libérées au 8 mai 1945.
« Forteresses allemandes dans la France libérée » de Stéphane Simmonet aux éditions Allary
Plus d’un an après le débarquement en Normandie, des dizaines de milliers de Français vivaient encore sous la domination allemande dans les zones appelées « Poches de l’Atlantique », englobant Dunkerque, Lorient et Saint-Nazaire. Ces cités étaient restées assiégées durant de longs mois par les Alliés et les Forces françaises de l’intérieur.
Ces longs sièges sont visibles à travers des images issues des archives du ministère des Armées, comprenant des photos capturées non seulement par les reporters alliés, mais également par ceux de l’armée allemande, ce qui demeure relativement rare.
Les images révèlent le quotidien de ces blocus : l’attente, la fatigue, les blessés, les morts, les ruines, mais aussi les discussions stratégiques entre officiers, notamment celles qui ont épargné La Rochelle de la destruction.
La ténacité allemande est bouleversante, obéissant jusqu’au bout aux instructions de résistance données par Hitler en 1944. Comme le souligne l’historien Stéphane Simmonet, cela illustre surtout un immense gaspillage de ressources et de vies humaines. Cependant, cela permet également de saisir l’impact profond de ces combats sur ces territoires.
« Vichy était-il la France ? » de Sébastien Ledoux aux éditions JC Lattès
Ce livre captivant explore l’évolution de la mémoire collective, notamment en ce qui concerne la Rafle du Vel d’Hiv : comment la France a-t-elle choisi de retenir cet événement et, plus largement, la déportation des Juifs ? Une mémoire qui s’est énormément transformée entre 1945 et 1995, l’année où Jacques Chirac a reconnu officiellement la responsabilité française.
L’historien Sébastien Ledoux retrace cette évolution, fournissant des exemples marquants, comme cet article de 1945 annonçant le retour du sport au Vélodrome d’Hiver sans mentionner la rafle. Celle-ci était par la suite absente de presque tous les manuels scolaires jusqu’aux années 1960, avant de réapparaître dans les débats publics des années 1970 et de s’ancrer fermement dans le récit national des années 1980.
Ce processus s’est concrétisé grâce au travail des anciens résistants, des historiens, et des organisations juives qui, au fil du temps, ont établi la vérité et influencé le discours public. Malheureusement, certains dirigeants préféraient le silence au nom de la réconciliation et de la grandeur nationale, mais ceux-ci ont réussi à établir ce que Charles Péguy qualifiait de « l’incommode image exacte » de la Nation.
Un travail crucial et qui reste menacé aujourd’hui, souligne l’auteur, face à la montée du révisionnisme et du nationalisme.