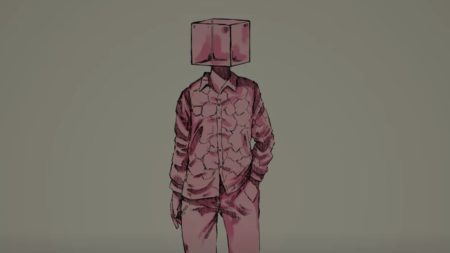Thomas François, Serge Hascoët et Guillaume Patrux font face à des accusations portées par six femmes, trois hommes ainsi que deux organisations syndicales, qui les accusent de comportements constituant du harcèlement moral et sexuel. Lors de la première journée de leur procès, qui s’est tenue ce lundi, quatre des victimes sont venues déposer leur témoignage devant la justice.
« J’ai ressentis une peur immense. » Devant le tribunal correctionnel de Bobigny (Seine-Saint-Denis), lundi 2 juin, Bérénice* a prononcé ces mots avec un mélange d’émotion contenue et de voix tremblante. Ses paroles résonnaient avec celles des trois autres victimes qui ont pris la parole lors de cette première audience du procès impliquant trois anciens dirigeants d’Ubisoft : Thomas François, Serge Hascoët et Guillaume Patrux. Ceux-ci sont jugés pour des faits de harcèlement moral, harcèlement sexuel ainsi que tentative d’agression sexuelle. Tous contestent les accusations portées contre eux.
Les plaintes ont été déposées par six femmes, trois hommes, ainsi que deux syndicats, qui reprochent aux accusés d’avoir maintenu, voire organisé, un environnement professionnel caractérisé par une humiliation constante, une violence normalisée et un mutisme imposé. Une enquête interne réalisée en 2020, à la suite des révélations publiées par Libération, évoquait une véritable « culture d’entreprise toxique ». La matinée a été l’occasion de mettre un visage et un témoignage humain sur les personnes victimes de cette pression oppressive.
Des requêtes à la limite de la dérision
Juliette*, stagiaire embauchée chez Ubisoft en 2010, décrit une réalité professionnelle qui flirtait souvent avec l’incompréhensible. En tant qu’assistante, elle devait, par exemple, trouver précisement des cacahuètes encore dans leur coque, ou effectuer un aller-retour express à Saint-Malo afin de récupérer une tablette, à la demande insistante de Serge Hascoët, alors considéré comme le second dirigeant d’Ubisoft : « Tu ne vas quand même pas empêcher les évaluations de mes équipes à cause de toi ? », lançait-il.
En 2014, après avoir vainement tenté d’alerter une directrice des ressources humaines, Juliette décide de changer de service. Pourtant, elle reste très liée au département « édito » : les assistantes qui ont pris sa suite la contactent régulièrement, se demandant si ce qu’elles vivaient était normal.
« À chaque fois, ça a mal tourné (…), elles ne sont pas restées longtemps. »
Juliette*, partie civileà la barre
Par exemple, Nathalie*, recrutée seulement trois semaines auparavant pour travailler auprès de Serge Hascoët, l’a rapidement appelée. De son ton calme, elle raconte comment, entre avril 2015 et mars 2016, elle a fait office de réceptacle pour toute la colère, les insultes et les humiliations déversées par ses supérieurs. « Je ne me sentais pas à l’aise avec ces exigences », confesse-t-elle, évoquant les courses effectuées dans l’urgence pour des « dîners de dernière minute » ou encore cette soirée où, en pleine activité personnelle, elle dut aller prêter un parapluie à son manager parce qu’il pleuvait.
« Un choc profond »
Similairement à Juliette*, les demandes personnelles se sont peu à peu intensifiées. Nathalie relate avoir dû gérer « toute la succession » de l’épouse de Serge Hascoët, s’occuper de sa fille de 6 ans au bureau et même une fois aller la récupérer à l’école. Chargée de faire le tampon entre son supérieur et les équipes, elle se souvient n’avoir « jamais connu une semaine sans dispute ». Evoluant dans un milieu très masculin, elle subissait régulièrement des railleries. « Tommy [Thomas François, ancien vice-président du secteur éditorial] me traitait principalement de ‘morue’ et parfois, quand il avait besoin de quelque chose, il m’appelait ‘ma jolie' », a-t-elle dénoncé.
« Il arrivait souvent qu’ils viennent m’insulter à mon bureau. »
Nathalie*, partie civileà la barre
L’année 2016 marque un tournant désagréable lorsqu’une conversation prend un tour déplacé, Serge Hascoët demandant à Nathalie ce qu’est l’ocytocine. « Il a affirmé que c’était l’hormone qui se libère lors de l’orgasme d’une femme. » Thomas François, qui était présent, a surenchéri en lançant : « Tu ne dois pas savoir ce que c’est, toi. » Ils ont ri, elle a encaissé. « J’en ai été très perturbée », admet-elle.
Cette scène ravive également un traumatisme subi quelques mois plus tôt lors d’une fête d’entreprise en 2015, où Nathalie* assure que Thomas François a essayé de l’embrasser contre son gré, alors que des collègues tentaient de l’empêcher de s’éloigner.
« Des accès de colère violente » sans raison évidente
Bérénice* garde elle aussi un souvenir pénible de Thomas François. Lors de sa première réunion en présence de Serge Hascoët, espérant faire « bonne impression », elle s’est retrouvée victime d’une humiliation : l’homme lui a dessiné des traits au marqueur sur le visage, riait et refusait de la laisser se nettoyer. C’était le début d’une longue série de vexations. Sur son banc, l’accusé restait impassible, la tête baissée.
« Je le craignais énormément, et évitais tout conflit, je ne voulais pas m’opposer. »
Bérénice*, partie civileà la barre
Elle relate également une punition liée à un pari perdu : elle a dû appliquer du vernis à ongles sur les orteils de son supérieur. « À la fin de la journée, il a jeté les flacons sur mon bureau. » « Je les ai jetés à la poubelle en sortant, » précise la jeune femme qui souhaite « ne rien garder de ce souvenir humiliant ». Elle affirme aussi avoir été témoin à plusieurs reprises des « colères noires » de Thomas François, sans motifs apparents. « C’était une des raisons pour lesquelles j’avais si peur de lui, » confie-t-elle.
« Je ne remettrai jamais les pieds dans une grande entreprise »
Benoît*, ancien graphiste 3D, témoigne de la même appréhension face à son supérieur Guillaume Patrux, également poursuivi. Ce dernier était réputé pour ses emportements et violences. « Entre ses coups portés aux murs, les objets qu’il brûlait, et l’usage d’un fouet, j’étais terrorisé, » relate-t-il, évoquant un moment où son chef lui a lancé une clé à molette dans les jambes.
« Ce qui m’a marqué, c’était son regard, sa rapidité, sa brutalité. »
Benoît*, partie civileà la barre
« J’ai compris que la violence était tolérée dans l’open space, et cela m’a tellement effrayé que, au lieu d’essayer de la combattre, j’ai choisi de la fuir », explique-t-il. À l’époque, conscient d’être simplement de passage et d’être considéré comme « insignifiant » dans l’équipe, il a souffert de crises d’angoisse, de perte de poids et d’insomnies. Il a supporté ces conditions sans jamais oser demander un arrêt maladie, étant donné qu’il était en CDD de courte durée. Suite à ces événements, il a décidé de ne plus jamais travailler dans le secteur du jeu vidéo. « Je sais que je ne pourrais plus jamais envisager un poste dans une grande entreprise, malgré mes qualifications, » confie-t-il avec une pointe d’amertume dans la voix.
* Les prénoms ont été modifiés.