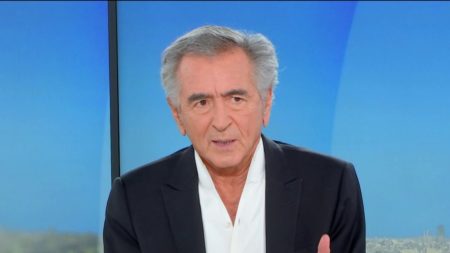Dans le cadre de la préparation du budget pour l’année 2026, François Bayrou ainsi que la ministre chargée du Travail envisagent de réaliser des économies en diminuant les dépenses liées à ce mécanisme. Ce dispositif, qui offre aux salariés la possibilité de bénéficier des allocations chômage, est critiqué puisqu’on lui reproche de remplacer de fait les départs volontaires ou les mises à pied. Leur objectif est donc de maîtriser et réduire les coûts associés à cette mesure.
Ce mécanisme, très apprécié, se retrouve désormais sous surveillance. Le gouvernement projette de renforcer les critères entourant la rupture conventionnelle, qui permet à un employeur et un salarié de mettre fin d’un commun accord à un contrat à durée indéterminée, tout en ouvrant des droits à l’allocation chômage. Alors que le Premier ministre François Bayrou a suggéré de lancer de nouvelles discussions autour de la réforme de l’assurance-chômage, dans le cadre des propositions d’économies budgétaires pour 2026 dévoilées le 15 juillet, la ministre déléguée au Travail a désigné parmi les points essentiels la lutte contre les éventuels « abus » liés à ce dispositif. Astrid Panosyan-Bouvet a réaffirmé cette volonté lors d’une interview accordée au Point jeudi 24 juillet, juste après avoir reçu les syndicats dans son ministère. Franceinfo vous détaille les règles actuelles, ainsi que les raisons et la manière dont le gouvernement envisage d’en modifier les modalités.
1 Quelles sont les dispositions actuelles encadrant la rupture conventionnelle ?
Créée en 2008, cette procédure visait à offrir plus de souplesse au marché du travail et à constituer une alternative au licenciement ou à la démission, en autorisant une séparation à l’amiable entre salarié et employeur. Pour l’employeur, ce mode de rupture devait limiter les risques de contentieux aux prud’hommes comparé au licenciement. Du côté du salarié, ce dispositif présentait l’avantage de permettre l’accès aux indemnités chômage, ce qui n’est pas le cas en cas de démission.
Pour bénéficier de cette rupture conventionnelle, il est impératif d’être embauché en CDI, précise le portail officiel de l’administration. La procédure est encadrée méthodiquement : un au moins un entretien préalable est obligatoire, suivi de la rédaction et de la signature d’une convention qui fixe les conditions de la rupture, notamment la date effective de fin du contrat et le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle. Cette indemnité « ne peut être inférieure à celle prévue légalement en cas de licenciement », souligne clairement l’administration. Les deux parties disposent d’un délai de quinze jours pour se rétracter. Ensuite, l’accord doit être homologué par l’État pour être valide. Le site administratif insiste sur le fait que cette rupture « ne peut être imposée ni par l’employeur, ni par le salarié ». En cas de pression exercée pour obtenir un consentement, le recours devant les prud’hommes reste possible.
2 Quelles modifications sont envisagées dans le cadre de la réforme ?
Dans le cadre de la prochaine réforme de l’assurance-chômage, le gouvernement ambitionne de réaliser une économie de l’ordre de « 2 à 2,5 milliards d’euros annuels sur la période 2026-2029, puis entre 3 et 4 milliards à l’horizon 2030 », d’après les estimations fournies par le ministère du Travail. Le 15 juillet, Astrid Panosyan-Bouvet a annoncé son intention de revoir la durée d’indemnisation ainsi que les critères d’accès pour l’ensemble des demandeurs d’emploi, avec un focus particulier sur les « modalités d’indemnisation » liées aux ruptures conventionnelles.
Parmi les pistes évoquées figure l’allongement du délai de carence, c’est-à-dire la période qui s’écoule entre la signature de la rupture conventionnelle et le début du versement des allocations chômage. Ce délai dépend notamment du montant des indemnités perçues lors de la rupture et peut varier entre 7 jours et 5 mois, selon les explications de France Travail. Le rallongement de ce délai pourrait contribuer à rendre ce dispositif moins attrayant et diminuer son coût pour l’assurance-chômage. « La modification du délai de carence est une option parmi plusieurs autres », a précisé la ministre au Point.
3 Sur quelles bases le gouvernement s’appuie-t-il pour justifier ce projet ?
Suite aux annonces du Premier ministre le 15 juillet, Astrid Panosyan-Bouvet a déclaré qu’il existait « objectivement de nombreux abus » concernant les ruptures conventionnelles, « tant du côté des salariés que des employeurs ». Elle a laissé entendre que ce dispositif pouvait parfois masquer des démissions déguisées ou des licenciements non formalisés.
Pour étayer son propos, l’exécutif se base sur une étude réalisée en 2018 par la Dares, l’organisme de statistiques du ministère du Travail. Cette analyse concluait que « les ruptures conventionnelles étaient principalement venues remplacer des démissions de CDI (environ 75 % entre 2012 et 2017) et, dans une moindre mesure, des licenciements économiques (entre 10 et 20 %) ». Seule une partie minoritaire des ruptures (entre 5 et 15 %) « n’aurait probablement pas eu lieu sans l’instauration de ce dispositif ».
Une autre recherche, publiée en 2019 par les économistes Cyprien Batut et Eric Maurin, avance une perspective différente : elle suggère que « l’introduction des ruptures conventionnelles dans un établissement correspond à une hausse globale des ruptures de CDI ». Cela témoignerait d’un phénomène plutôt additionnel, où ces ruptures interviennent en sus des licenciements et des démissions, au lieu de simplement les remplacer.
Dans son entretien au Point, la ministre estime par ailleurs que les allocations chômage post-rupture conventionnelle servent parfois à certains salariés comme « un revenu de confort », particulièrement chez « des personnes expérimentées en milieu de carrière, très qualifiées », ce qui retarde leur recherche d’emploi active. Elle invite les partenaires sociaux à « réajuster le système », afin qu’il renouvelle son objectif initial : assurer « un filet de sécurité » en cas de rupture.
4 Quel est le coût annuel lié à ce mécanisme ?
En 2024, près de 515 000 ruptures conventionnelles individuelles ont été conclues, d’après les données fournies par le ministère du Travail. Cela représente une hausse notable comparée à 2015, où 315 000 cas avaient été recensés, reflétant une tendance à l’augmentation du recours à ce dispositif, bien que le volume soit stable depuis 2022. Dans l’ensemble des ruptures de CDI, ce mode demeure moins fréquent que les démissions (1,85 million en 2024) et les licenciements (583 000), selon les chiffres de la Dares.
En 2022, France Travail a versé environ 9 milliards d’euros d’allocations aux salariés indemnisés suite à une rupture conventionnelle. Ils représentaient alors 28 % du total des allocations distribuées, alors qu’ils comptaient pour 25 % des bénéficiaires, selon Unédic. Ce léger décalage s’explique par le fait que cette rupture concerne exclusivement des anciens salariés en CDI, souvent mieux rémunérés que la moyenne, ce qui engendre des indemnités chômage plus élevées.
5 Quelles sont les réactions des syndicats et des représentants des employeurs ?
Lors de la première réunion consacrée à la réforme de l’assurance-chômage, organisée lundi au ministère du Travail, seuls les syndicats CFDT et CFTC ont répondu présents. Marylise Léon, présidente de la CFDT, a qualifié le projet global présenté par le gouvernement de « carnage total pour les demandeurs d’emploi ». Du côté de la CGT, Denis Gravouil, secrétaire confédéral chargé de ce dossier, a exprimé à 42mag.fr son opposition farouche, dénonçant un projet « absolument inacceptable ». Tous deux ont également dénoncé auprès du Monde la proposition de durcir les règles autour des ruptures conventionnelles. Denis Gravouil accuse le gouvernement de prétendre que « les salariés abusent du dispositif », alors qu’à ses yeux « ces ruptures sont souvent de véritables licenciements déguisés ».
De leur côté, les représentants patronaux se montrent plus ouverts à certaines modifications, tout en nuançant leur position. Dans le quotidien Le Monde, Jean-Eudes Tesson, président de l’Unédic et militant du Medef, reconnaît que la rupture conventionnelle a « considérablement aidé à apaiser des situations conflictuelles », mais souligne qu’elle se substitue souvent aux démissions, ce qui génère « des surcoûts à la fois pour les employeurs et pour l’assurance-chômage ». Eric Chevée, vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), avertit que les entreprises de taille moyenne tiennent « beaucoup » à ce dispositif, tout en notant que la perception est probablement différente chez les très petites structures, lesquelles estiment que « certains salariés abusent parfois du système ».