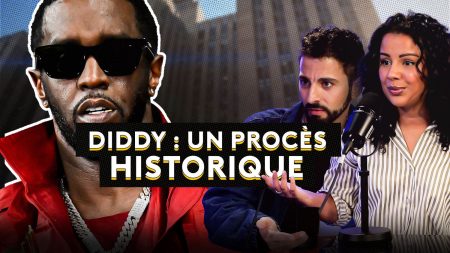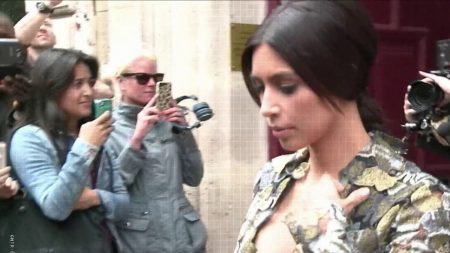Le gouvernement français a eu recours au 49.3 le 16 mars dernier, ce qui a entraîné l’arrestation de plusieurs manifestants. Depuis, vingt avocats ont déposé des plaintes contre une personne ou un groupe de personnes non identifiées, au nom de leurs clients. Ces plaintes ont été déposées dans l’espoir de faire la lumière sur les actes qui ont conduit à l’arrestation de leurs clients. Les avocats espèrent que les coupables seront identifiés et punis en conséquence.
Vingt avocats ont déposé plus de 100 plaintes auprès du parquet du tribunal judiciaire de Paris contre des arrestations et des détentions « arbitraires, visant à dissuader [les manifestants] d’exercer leur droit de manifester et à casser le mouvement social » contre la réforme des retraites. Les plaignants sont représentés par les avocats pour être placés en garde à vue depuis le recours au 49.3 par le gouvernement pour faire adopter le texte de loi. Cette procédure, qui prive « le mis en cause d’une audience publique » et qui peut notamment aboutir à une interdiction de manifester ou de se rendre à Paris pour une durée de six mois, est également dénoncée.
Selon les chiffres du parquet de Paris, au cours des deux semaines précédant la dernière journée de mobilisation, 952 personnes ont été placées en garde à vue, mais seules 43 ont fait l’objet d’une comparution immédiate devant le tribunal. La majorité a été relâchée sans poursuites, avec un classement sans suite. D’autres ont été présentées à un délégué du procureur en vue d’un « classement sans suite sous conditions ». Les pénalistes s’attendent à recevoir d’autres plaintes pendant les jours à venir.
Les plaignants et leurs avocats critiquent également les motifs des interpellations lors des manifestations. Ils signalent que la plupart des manifestants sont arrêtés pour « participation à un groupement en vue de la préparation de violences et de destructions », un délit puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende. Cependant, certains dénoncent un abus des forces de police pour dissuader les personnes de revenir manifester. « Ce sont des gardes à vue « sanctions », pour dissuader les personnes de revenir manifester », affirme Coline Bouillon, l’une des avocates des plaignants.
Les plaignants et leurs avocats relèvent également que le fait d’être placé en garde à vue jusqu’à 48 heures sans être poursuivi par la suite ne peut faire l’objet d’une réparation pour « privation de liberté injustifiée au sein d’un commissariat », car le droit français ne le prévoit pas. Par conséquent, « le seul moyen d’obtenir réparation consiste à déposer la présente plainte », écrivent-ils. Le délit d' »entrave à la liberté de manifester » doit également être appliqué lorsque les forces de l’ordre et leur hiérarchie font un usage illégitime de leur pouvoir, ce qui a eu pour effet de créer de la stupeur et de l’effroi parmi les manifestants qui se trouvaient dépossédés de la possibilité d’exercer pleinement leur liberté.
L’Inspection générale de la police nationale a été saisie de 17 enquêtes judiciaires depuis la première journée nationale de mobilisation, le 19 janvier. Parmi celles-ci, l’une vise des policiers de la Brav-M, une brigade motorisée décriée, enregistrés en train de tenir des propos menaçants et humiliants à l’égard de jeunes manifestants interpellés dans la capitale.