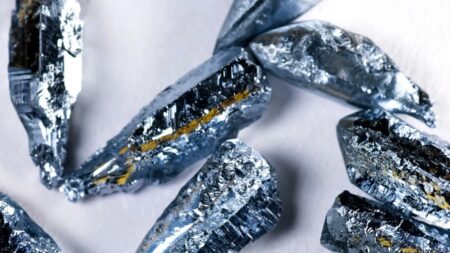La réforme controversée des retraites en France a été largement approuvée vendredi et devrait entrer en vigueur le 1er septembre
Le président français, Emmanuel Macron, n’a pas perdu de temps pour faire inscrire dans les textes législatifs les réformes controversées des retraites de son gouvernement.
Quelques heures à peine après la plus haute instance constitutionnelle française, Le Conseil constitutionnel, a largement approuvé les changements – qui verront l’âge minimum de départ à la retraite relevé de 62 à 64 ans -, vendredi 14 avril, M. Macron a promulgué la loi. Cela signifie que les changements devraient entrer en vigueur le 1er septembre.
Cette décision a porté un coup dur à la majorité des Français qui s’opposent aux réformes et aux centaines de milliers de personnes qui ont manifesté ces derniers mois.
Alors, que signifiera la décision de M. Macron pour les manifestations et les grèves ? Vont-ils se rallumer ou s’éteindre lentement ?
Le 1er mai contribuera-t-il à relancer le mouvement de contestation ?
Au lendemain de la Conseil constitutionnel décision, les syndicats français ont appelé à davantage d’actions revendicatives.
On s’attend à des perturbations sur les chemins de fer jeudi 20 avril après que quatre principaux syndicats des chemins de fer – CFDT, CGT, Sud-Rail et UNSA – ont appelé à la grève. La CGT a également appelé à un débrayage vendredi prochain (28 avril).
Mais le grand est le 1er mai. Cette date est un jour férié annuel en France et s’appelle la fête du travail. Il voit les travailleurs – et les progrès dans la protection de leurs droits – célébrés par des marches et des manifestations. Cette année, il devrait être utilisé pour mobiliser l’opposition aux réformes des retraites.
« Les gens vont descendre dans la rue car c’est un jour férié et une date symbolique pour les syndicats », explique Bruno Cautrès, chercheur au CEVIPOF de Sciences Po. La Connexion.
Le 1er mai tombe à pic pour les syndicats. La participation n’a cessé de baisser ces dernières semaines. La dernière journée nationale de grèves jeudi dernier (13 avril) a vu 380 000 personnes dans les rues, selon les chiffres du ministère français de l’Intérieur. Les syndicats contestent cela, affirmant qu’il y avait un million de manifestants.
Selon le ministère de l’Intérieur, il y avait 1,28 million de manifestants le 7 mars. Les syndicats ont déclaré qu’il y avait 3,5 millions de manifestants.
« Est-ce que cela va [a big turnout] être un effet du 1er mai ou jusqu’à la mobilisation des manifestants [by Mr Macron’s promulgation of the law]? Il est trop tôt pour appeler », a déclaré M. Cautrès.
« S’il refuse, il y aura beaucoup de colère et de rage »
Une autre date clé qui pourrait dicter la reprise des manifestations survient deux jours plus tard, le mercredi 3 mai.
C’est alors que la France Conseil constitutionnel statuera sur une deuxième demande d’organiser un référendum sur la réforme des retraites.
Il a rejeté le premier dans son jugement de vendredi dernier.
« La réforme est prise entre deux périodes », a déclaré Michel Wievorka, sociologue et spécialiste des mouvements sociaux. La Connexion.
« Si la Conseil constitutionnel permet le [second] référendum, il ouvrira le pays à une myriade d’initiatives de l’opposition pour garantir son [the referendum’s] succès », a déclaré M. Wievorka.
« S’il refuse, il y aura beaucoup de colère et de rage », a-t-il ajouté, prédisant des actions plus violentes au sein des manifestations.
Le discours de Macron à la nation
Lundi 17 avril, M. Macron fait un discours télévisé à la nation dans une tentative apparente de tourner la page d’un chapitre controversé.
Il a reconnu que les réformes n’avaient pas été acceptées par une majorité de Français.
M. Macron a également tenté de faire avancer le débat en s’engageant à travailler à l’amélioration des hôpitaux et de l’ordre public en France.
Mais son discours a semblé faire peu pour calmer ses détracteurs.
Alexis Corbière, d’extrême gauche La France Insoumise parti, a déclaré que le discours était « un autre exercice d’arrogance politique ».
« Le discours ne signifie pas que les Français vont passer à autre chose », a déclaré M. Cautres, ajoutant qu' »un fort sentiment d’injustice demeure dans l’air ».
« J’exclus tout refroidissement rapide et satisfaisant de la situation », a ajouté M. Wievorka. « Rien d’important ne se passera avant mai. »