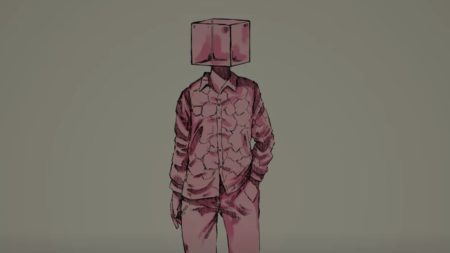Le jugement impliquant trois anciens dirigeants d’Ubisoft a pris fin jeudi. Selon les témoins et les victimes, la reprise de leur carrière a été profondément entravée par le mutisme persistant au sein du secteur du jeu vidéo ainsi que par la peur d’être exclues ou mises à l’écart du milieu professionnel.
« Suite à mon expérience chez Ubisoft, j’avais décidé de ne jamais retourner dans l’industrie du jeu vidéo. » Derrière ses lunettes épaisses, le regard de Nathalie* est intense. Cette jeune femme n’a pas quitté un instant la salle d’audience où s’est déroulé le procès opposant trois anciens dirigeants de la célèbre société française de jeux vidéo. Elle fait partie des premières plaignantes, ayant déposé une plainte en 2021 contre un système qui l’a complètement « anéantie ». Quatre ans plus tard, Thomas François, ancien vice-président éditorial, Serge Hascoët, autrefois numéro deux du groupe, ainsi que Guillaume Patrux, ex-game director, étaient jugés pour des faits de « harcèlement moral et sexuel ».
Le verdict ne sera rendu que le 2 juillet. Les lumières de la salle d’audience se sont éteintes jeudi 4 juin, mais les plaies restent profondes. Ce procès a ouvert une fissure dans un secteur longtemps aveugle à la violence qu’il engendre. Les récits des victimes et les conversations dans les couloirs du tribunal ont révélé le lourd tribut payé par celles qui ont eu le courage de témoigner : des parcours professionnels brisés, une précarité durable, et des blessures psychologiques toujours vivaces.
« Ce qui m’a brisé, c’est d’avoir été mis au placard »
Peter*, qui fait également partie des plaignants, a raconté à la barre la fierté qu’il éprouvait en rejoignant en 2015 l’une des figures de proue du jeu vidéo en France, fierté rapidement éclipsée par un profond malaise. Dès ses premiers jours, il s’est demandé « ce que je faisais là », plongé dans une « ambiance d’enfants tyranniques sans aucune règle pour les freiner. » Ce n’est pas la passion du métier qu’il remet en question. Il a « adoré travailler chez Ubisoft » et estime que « tout n’était pas à rejeter ». Non, « ce qui m’a anéanti », c’est d’avoir été « exclu » et « mis de côté » parce qu’il n’a pas adhéré à « la culture fun » prônée par la société.
En tant que délégué du personnel, il affirme avoir tenté d’alerter sa hiérarchie, sans succès. Il critique une entreprise où « les droits semblaient laissés à la porte dès qu’on franchissait l’entrée. » La pression constante l’a contraint à solliciter un avocat pour sécuriser son départ. Il a finalement signé une rupture conventionnelle en 2018. Depuis, il lui est toujours difficile de « contrôler la montée d’émotions » lorsqu’il repense à cette période. « Ce matin, je n’étais pas sûr d’avoir la force de venir en parler », a-t-il reconnu devant le tribunal, la voix chargée et un mouchoir trempé entre les mains.
Son ancien responsable, Arnault Labaronne, a également souffert de son passage chez Ubisoft. En 2015, il a quitté l’entreprise après avoir négocié une rupture conventionnelle avec une indemnité de 15 000 euros, convaincu qu’il devait s’éloigner pour protéger sa santé. Il a dû faire face à un burn out qui lui a laissé des séquelles physiques et psychologiques : douleurs articulaires, perte d’audition à une oreille, crises d’angoisse répétées.
« Je n’ai plus jamais pu remettre les pieds dans une entreprise avec un organigramme. »
Arnault Labaronne, ancien collaborateur chez Ubisoftà 42mag.fr
Il confie avoir longtemps eu des difficultés à se réintégrer dans un travail collectif. Peu à peu, il a retrouvé une place dans le milieu professionnel et a pu « aller de l’avant ». Arnault Labaronne a néanmoins décidé de ne pas porter plainte après son audition par les enquêteurs, estimant avoir déjà « tiré un trait » sur cet épisode.
« Je sais que j’ai été mise sur liste noire »
Clarisse* avait 22 ans lorsqu’elle a intégré Ubisoft. Elle travaillait au département communication, dans le même bâtiment que le service éditorial, mais à un étage différent. Elle se souvient du silence lourd dans les couloirs, du bruit de ses talons qui résonnaient, et des regards masculins qui se retournaient à son passage. Sur son ordinateur, dès qu’elle s’installait, elle recevait une avalanche de messages à caractère sexuel. Son supérieur comparait ces notifications incessantes à un « sapin de Noël qui clignote. »
En 2015, après avoir tenté de signaler à ses supérieurs le comportement déplacé de certains collègues, elle s’est fait licencier. Sur les recommandations de son avocat, elle a poursuivi l’entreprise pour licenciement abusif, sans mentionner le harcèlement, et a remporté le procès aux prud’hommes. Quand l’affaire a éclaté en 2020, il était trop tard pour qu’elle puisse s’ajouter aux parties civiles, les faits la concernant étant prescrits. Elle a alors assisté aux audiences en tant que spectatrice et soutient les victimes dont les récits résonnent avec son vécu.
Aujourd’hui encore, Clarisse craint le monde du salariat. Elle se sent en « hypervigilance permanente » et la panique monte en elle lorsque ses collègues masculins lui proposent un verre.
« Je surinterprète chaque geste, chaque parole. »
Clarisse, ancienne employée chez Ubisoftà 42mag.fr
Nathalie* partage les mêmes troubles. Depuis sa période passée chez Ubisoft, elle « méfie systématiquement des relations en entreprise. » Chaque directive soulève en elle des doutes : « La personne qui me parle agit-elle en tant que manager ? Est-ce que nous sommes dans un cadre professionnel ? » Ces confusions ont brouillé « la valeur » qu’elle se portait.
Depuis son départ, elle n’a jamais retrouvé de stabilité au travail. Elle pense avoir compris pourquoi certaines offres d’emploi ne lui parvenaient jamais, malgré ses qualifications. « Je sais que j’ai été blacklistée », lâche-t-elle en haussant les épaules.
« C’est un monde très incestueux, celui du jeu vidéo. Tout le monde se connaît. »
Nathalie, ancienne salariée d’Ubisoftà 42mag.fr
À 36 ans, Nathalie est au chômage et peut compter sur l’aide de sa famille. « Heureusement que je suis économe et que j’ai pu mettre un peu d’argent de côté », confie-t-elle, consciente que « cela ne durera pas éternellement ».
« Je me sens diminué sur le plan artistique »
Chakib Mataoui, représentant du syndicat Solidaires Informatique, n’est pas surpris par cet isolement. L’univers du jeu vidéo, explique-t-il, est très fermé, sans vraies passerelles vers d’autres secteurs. « Des métiers très spécifiques, qu’ils soient techniques ou artistiques, restent enfermés dans ce milieu. » Depuis le lancement du procès, de nombreux témoignages continuent d’affluer. « Mais les personnes constateront vite que les victimes vivent toujours dans la précarité. », déplore-t-il.
Benoît*, victime et partie civile, illustre ce ralentissement après Ubisoft, qui ne se résume pas aux seuls aspects financiers. Diminution de poids, troubles du sommeil, perte de repères. Lors de son expertise psychologique en 2023, il expliquait vomir « presque tous les jours. » La simple idée de recroiser un ancien collègue le paralyse encore et il refuse désormais toute candidature dans le secteur « même au prix de difficultés financières majeures. » Il qualifie son dépôt de plainte d’« acte de désespoir ».
« De toute manière, je n’ai plus rien à perdre, je ne remettrai jamais les pieds dans une entreprise. »
Benoît*, victimelors de son expertise psychologique
Aujourd’hui, il tente de se raccrocher à sa passion première : la création. Mais reprendre confiance est une route semée d’embûches. « J’ai tout perdu : la confiance en moi, la fierté artistique. Je me sens nul dans ce domaine. », confie-t-il entre deux audiences. Il a exclu le salariat de son avenir : « Depuis Ubisoft, je n’ai plus réussi à remettre un pied dans une entreprise de jeux vidéo. » Actuellement, il travaille en indépendant, dans une situation « extrêmement précaire. » Il avoue aussi qu’après le confinement, il a même été sans-abri pendant une période. Pour lui – comme pour beaucoup d’autres –, le jeu vidéo n’était pas qu’un métier, mais une vraie vocation. Et il refuse d’y renoncer.
« Pour parler, il faut une force immense »
Se manifester publiquement, c’est s’exposer à l’isolement, à la stigmatisation, et à l’étiquette infamante de « victime. » Pierre-Etienne Marx, représentant du Syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo (STJV), souligne « qu’il faut une force immense pour oser demander justice. » Dans ce petit milieu où certains dirigeants se vantent parfois de pouvoir « blacklister un nom d’un simple coup de fil, » dénoncer les comportements abusifs de sa hiérarchie est un acte loin d’être anodin.
« Lorsque l’on engage une procédure judiciaire, on risque de voir son nom terni. »
Pierre-Etienne Marx, porte-parole du STJVà 42mag.fr
Pendant que certains peinent à se reconstruire et que d’autres luttent encore pour être entendus, les carrières des accusés ont elles aussi pris un tournant. Tous ont quitté Ubisoft suite aux révélations publiées par Libération en juillet 2020.
Serge Hascoët, ancien directeur créatif, a affirmé à la barre percevoir aujourd’hui plus de 20 000 euros par mois grâce à son cabinet de conseil, aux royalties provenant de ses jeux, et à la location d’un bien immobilier. Quand il occupait le poste de numéro deux d’Ubisoft, son salaire dépassait les 50 000 euros mensuels.
Thomas François, quant à lui, a opté pour le statut d’auto-entrepreneur. Il explique chercher activement du travail et avoir « une ou deux pistes. » En 2023, il a facturé environ 6 000 euros, puis 9 000 en 2024.
Enfin, Guillaume Patrux vit sans source de revenu régulière. Locataire, il a déploré devant la cour ne plus parvenir à « boucler ses fins de mois. »
Lors de la dernière journée du procès, Sophie Clocher, avocate du Syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, a tenté de résumer ce désastre collectif : « Nous en sommes là parce que ce sont des femmes, des personnes issues de minorités, qui sont devenues invisibles. » Elle a ajouté que ces invisibles « ne doivent plus être exploités comme des marchepieds ou des domestiques, mais exister enfin dans la conscience des dirigeants. »
*Les prénoms ont été changés.