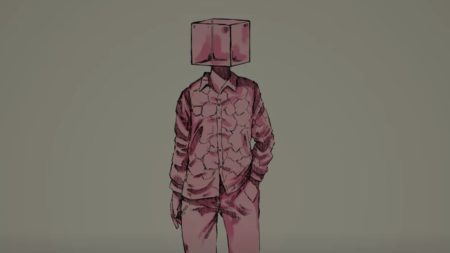Lors de son passage sur l’émission « 11h/13 », Justine Atlan, qui dirige l’association E-enfance/3018, attire l’attention sur les risques associés à l’usage de Roblox par les mineurs, évoquant à la fois l’exposition à des prédateurs sexuels et les dangers d’addiction, tout en insistant sur l’importance de la vigilance et du soutien apporté par les parents.
Les jeux vidéo occupent aujourd’hui une place centrale dans les échanges entre jeunes. Roblox, en particulier, mobilise des millions d’enfants, parfois très jeunes, sur sa plateforme. Quels risques peut-on retracer dans cet univers? Justine Atlan, directrice de l’association E-enfance/3018, met en garde contre les dangers potentiels pour les mineurs, notamment l’exposition à des prédateurs sexuels et les mécanismes susceptibles de créer une addiction, lors de l’émission « 11h/13 » du vendredi 3 octobre. Elle est interrogée par Florence O’Kelly et Marianne Théoleyre, animatrice de « C quoi l’info ».
Ce texte correspond à une partie de la retranscription de l’interview évoquée ci-dessus. Pour visionner l’intégralité, cliquez sur la vidéo.
Florence O’Kelly : Quelle dangerosité peut présenter Roblox, plateforme encore peu connue d’un grand nombre d’adultes qui n’ont pas d’enfants en âge d’y jouer, est-ce que vous en aviez déjà pleinement conscience avant les affaires qui ont dernièrement mis ce sujet sous les projecteurs ?
Justine Atlan : Oui, tout à fait. Les jeux vidéo restent aujourd’hui un angle mort en matière de protection des mineurs sur Internet. La vigilance est surtout dirigée vers l’exposition à des contenus à caractère pornographique ou vers les réseaux sociaux, et une sensibilisation demeure nécessaire. Mais on a tendance à oublier que les jeux ne se résument pas à du divertissement : ils constituent aussi de véritables lieux de socialisation. On y trouve des systèmes de messagerie, des forums… En somme, Roblox et d’autres espaces se rapprochent de réseaux sociaux, tout en restant liés à l’univers du jeu.
Ces environnements séduisent particulièrement les adolescents et, plus encore, les garçons. Or, nombre de parents ignore la manière dont leurs enfants les utilisent. Pourtant, ces endroits sont des lieux de rencontres qui peuvent être enrichissants, mais qui comportent aussi des risques. Les prédateurs savent très bien où chercher les jeunes, en ligne comme hors ligne. Et ces univers, peu familiers aux adultes, leur offrent un terrain propice pour entrer en contact avec des mineurs.
Marianne Théoleyre : La question qui se pose est celle de l’absence quasi-totale de vérification d’âge sur ces plateformes. Comment est-ce possible, alors même que des adultes et des prédateurs peuvent y accéder librement ?
Justine Atlan : En effet, tout l’écosystème numérique — réseaux sociaux et plateformes de jeux — s’est construit ces deux dernières décennies sans mettre en place de mécanismes sérieux de vérification d’âge. Concrètement, cela signifie que mineurs et adultes se retrouvent dans les mêmes espaces, sans possibilité de les distinguer clairement l’un de l’autre.
Généralement, les plateformes affichent une limite d’âge, souvent 13 ans, mais elles se contentent de demander une date de naissance sans aucun système de contrôle effectif. Conséquence : de nombreux enfants mentent sur leur âge pour accéder à ces services. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : on estime à 40 millions le nombre d’enfants de moins de 13 ans présents sur Roblox. Juridiquement, rien ne les en empêche aujourd’hui : il ne s’agit que de conditions générales d’utilisation, sans contrainte réelle. Ainsi, ces mineurs se retrouvent massivement dans des espaces qui ne leur sont pas destinés, exposés à des adultes, parfois des prédateurs, qui savent très bien comment les identifier et entrer en contact avec eux.
Florence O’Kelly : Au-delà de ce premier problème, se pose aussi celui de l’addiction. Certains réclament l’interdiction d’accès à ces plateformes avant 13 ans, parfois 15 ans. Or, dans le même temps, elles sont conçues pour attirer précisément ce jeune public et nourrir cette dépendance ?
Justine Atlan : Effectivement. Nous avons laissé se développer ces plateformes sans anticiper leur impact, comme ce fut le cas pour les réseaux sociaux. Leur modèle économique repose sur la captation de l’attention et sur des mécanismes destinés à stimuler la production de dopamine à chaque interaction, qu’il s’agisse d’une vidéo, d’une story ou d’un contenu partagé. Ces procédés rendent les utilisateurs dépendants, mineurs comme adultes.
La différence tient au fait que le cerveau des adolescents est en pleine construction. Les neurosciences démontrent qu’il est particulièrement vulnérable et que ces habitudes influencent durablement son développement. Une fois installés, ces mécanismes sont difficiles à déconstruire.
On l’a vu avec TikTok : malgré l’absence initiale de preuves scientifiques formelles, les dégâts constatés ont suscité des inquiétudes suffisamment fortes pour que la France et la Commission européenne prennent des mesures, en appliquant le principe de prudence et en introduisant de nouvelles régulations.
Marianne Théoleyre : Concrètement, que peuvent faire les parents, grands-parents ou proches pour accompagner les enfants dans ces usages ?
Justine Atlan : La première étape consiste à s’y intéresser, même si cela peut être délicat. Il faut s’informer, poser des questions et engager le dialogue avec l’enfant : « Connais-tu Roblox ? Est-ce que tu y joues aussi ? ». Quand les jeunes aiment partager ce qu’ils font, cela permet de mieux comprendre leur univers et de valoriser leurs expériences. Il ne faut pas adopter uniquement un discours négatif, sous peine que l’enfant se referme. Il convient au contraire de reconnaître les aspects positifs tout en établissant des règles claires : des créneaux de connexion, des horaires et une sensibilisation continue aux risques.
Enfin, il est important d’apprendre aux enfants à ne jamais communiquer d’informations personnelles en ligne. Les plateformes prévoient théoriquement des garde-fous empêchant l’échange de coordonnées, mais il revient également aux parents de rappeler ces règles de prudence.
Ce texte correspond à une partie de la retranscription de l’interview évoquée ci-dessus. Pour visionner l’intégralité, cliquez sur la vidéo.