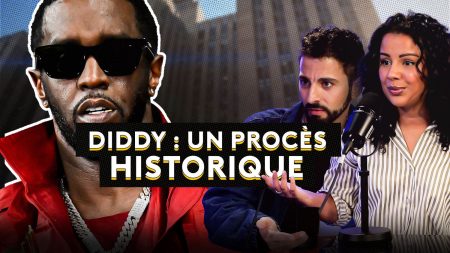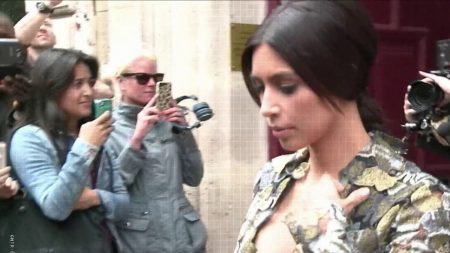Grâce au soutien des députés de la majorité, des Républicains et du Rassemblement national, l’article 3 du projet de loi porté par Eric Dupond-Moretti a été validé par l’Assemblée nationale. Cette approbation témoigne d’un large consensus politique regroupant différents groupes parlementaires et souligne ainsi l’importance accordée à cette mesure législative. L’engagement de ces élus provenant de divers horizons politiques permet de renforcer la légitimité et la solidité de cette proposition de loi. Le vote positif en faveur de cet article démontre également la volonté des différents partis de trouver des terrains d’entente et de travailler ensemble dans l’intérêt de la nation. Ainsi, cette décision politique reflète non seulement la valeur accordée à cette réforme, mais aussi la capacité des élus à dépasser les clivages partisans pour faire avancer les dossiers importants. Ce vote est donc porteur d’espoir quant à la possibilité de mettre en place des politiques publiques efficaces et consensuelles. La diversité des formations politiques représentées au sein de l’Assemblée nationale témoigne de la pluralité démocratique et de la richesse des débats qui animent notre institution démocratique. C’est dans ce contexte que l’article 3 a été adopté, montrant ainsi la force de la démocratie en action. Il s’agit d’une étape cruciale dans le processus législatif, démontrant la volonté des députés de travailler conjointement à la recherche de solutions pour répondre aux besoins et aux attentes des citoyens. Cette approbation est le fruit d’un travail d’échanges, de négociations et de compromis entre les différentes sensibilités politiques, témoignant d’une démarche constructive au sein de la représentation politique française. En somme, l’adoption de cet article dans le projet de loi d’Eric Dupond-Moretti est une étape majeure pour la mise en œuvre d’une réforme attendue et nécessaire.
Nouvel outil technologique ou atteinte aux libertés ? Les députés ont voté mercredi 5 juillet l’article 3 du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice, qui contient plus de 150 alinéas et modifie de nombreux points de la procédure pénale. Une disposition en particulier a suscité un débat animé : la possibilité d’activer à distance des téléphones portables, des ordinateurs et d’autres objets connectés pour écouter et filmer à leur insu des personnes visées dans certaines enquêtes. Au total, 80 députés de la majorité, des Républicains et du Rassemblement national ont voté pour, tandis que 24 élus de la Nupes se sont opposés. Bertrand Pancher, président du groupe Liot, s’est également opposé à cette mesure. Mais que prévoit exactement ce texte ? Et quelles critiques lui sont opposées ? 42mag.fr fait le point.
L’activation à distance des objets connectés
En vertu du texte, l’article permet l’activation à distance de téléphones portables, d’ordinateurs et d’autres objets connectés dans deux cas distincts. Le premier cas autorise la géolocalisation pour suivre en temps réel les déplacements de personnes visées par une enquête pour crime ou délit puni d’au moins cinq ans de prison. Le second cas concerne les personnes visées dans des affaires de terrorisme, de délinquance et de criminalité organisée et permet de capter à distance des sons et des images issues de téléphones portables, d’ordinateurs et d’autres objets connectés.
Ces procédures sont encadrées. L’activation d’un téléphone ou d’un objet connecté doit être approuvée par un juge et limitée dans le temps, selon le texte publié sur le site de l’Assemblée nationale. La captation d’images et de sons ne sera autorisée que dans les affaires les plus graves, pour une durée de 15 jours renouvelables une fois par le juge des libertés et de la détention, et pour deux mois renouvelables par un juge d’instruction, jusqu’à un maximum de six mois. En outre, le texte précise que cette activation ne peut pas concerner les appareils électroniques utilisés par les députés, les sénateurs, les magistrats, les avocats, les journalistes ou les médecins.
Pourquoi ce texte est-il critiqué ? Le projet de loi ne plaît pas aux députés de gauche qui s’opposent fermement à ces mesures « d’intrusion dans la vie privée », ainsi qu’à plusieurs avocats et associations. « Ce projet de loi est délétère », dénonce Ersilia Soudais, députée de La France insoumise, soutenue par son collègue Antoine Léaument. « Vous êtes en train de nous fournir un monde exactement comme dans 1984 », critique-t-il, en lisant un extrait du livre de George Orwell dans l’Hémicycle, rapporte LCP. « Les garanties encadrant ces mesures ne sont pas satisfaisantes », réagit pour sa part Cécile Untermaier, députée socialiste, sur Twitter. Les avocats dénoncent également une atteinte aux libertés. Le Conseil national des barreaux a ainsi demandé le retrait pur et simple du texte auprès du garde des Sceaux, selon un communiqué. La profession craint une « possible banalisation des atteintes aux libertés individuelles » et dénonce des « techniques de surveillance continue » qui remettent en question le droit à la vie privée. De son côté, le Conseil d’État a émis un avis sur le projet de loi ce printemps, dans lequel il fait remarquer que « ce mode opératoire a perdu de son efficacité face à des délinquants qui ont appris à s’en prémunir ».
Pour justifier la nécessité de ces captations, le garde des Sceaux les compare à la « vieille technique » de la pose de micros ou de caméras chez des suspects, et souligne qu’elles ne concernent que « quelques dizaines d’affaires par an ». Il fait également valoir que l’activation à distance d’appareils connectés est déjà utilisée par « les services de renseignement », sans nécessiter l’autorisation d’un juge. Enfin, en ce qui concerne la géolocalisation, le ministre justifie son utilisation en expliquant qu’elle existe déjà grâce à des balises et au bornage des téléphones, dans le cadre de crimes et de délits punis d’au moins trois ans de prison.
Le recours aux télécommunications
Deux paragraphes sont consacrés à l’utilisation des télécommunications, en particulier lors des gardes à vue. Le premier paragraphe permet la possibilité d’une téléconsultation pour un examen médical d’une personne majeure lors de la prolongation de la garde à vue. Cela est autorisé « si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges ». Cependant, le médecin peut demander un examen physique s’il le juge nécessaire. Dans le cas où la personne en garde à vue ne parle pas français, le texte permet également aux interprètes d’intervenir à distance. Cela se fait « par l’intermédiaire de moyens de télécommunication dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment avec son avocat », précise le texte.
Pourquoi cela suscite-t-il des critiques ? L’utilisation des télécommunications « inquiète » notamment le Conseil de l’ordre des avocats qui « déplore le recours à des moyens de télécommunication pour les interventions fondamentales de l’interprète et du médecin, notamment en garde à vue ». Cette inquiétude est partagée par la Défenseure des droits. Dans un avis publié début juin, Claire Hédon estime que le premier examen médical, même s’il a lieu pendant la prolongation de la garde à vue, doit permettre à la personne d’être examinée par un médecin. En ce qui concerne l’intervention à distance d’un interprète, elle souligne le « manque de moyens matériels et par conséquent les répercussions de l’utilisation de moyens de télécommunication dégradés sur la communication entre l’interprète et la personne concernée ».
Les perquisitions de nuit pour les crimes de droit commun
Dans cet article 3, le texte prévoit également l’extension du recours aux perquisitions de nuit, qui étaient jusqu’à présent réservées à un champ très limité de la criminalité, aux crimes de droit commun. L’objectif est de « préserver les preuves et d’éviter une nouvelle infraction », justifie le texte.
Pourquoi cela suscite-t-il des critiques ? Il s’agit d’une disposition qui vise à « remettre en question le principe d’inviolabilité du domicile », dénonce Andrée Taurinya, députée insoumise, lors des débats. Un point de vue partagé par Jérémie Iordanoff, député écologiste, qui estime que ce texte « donne la permission d’utiliser des techniques d’investigation particulièrement intrusives en les étendant aux crimes de droit commun ». En plus des politiciens, cette mesure est considérée, tout comme l’article 3 du projet de loi, comme une « violation des droits de la défense », dénonce le Conseil national des barreaux. De son côté, le Conseil de l’ordre des avocats de Paris estime dans un communiqué que ce type de perquisitions est étendu « dans des conditions telles que le principe de leur prohibition devient inexistant ».