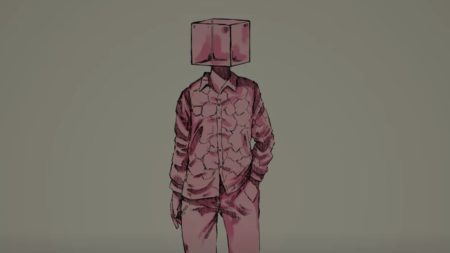L’interprète a déposé une plainte à l’encontre de Benoît Jacquot et Jacques Doillon, entraînant l’ouverture d’une enquête préliminaire par le tribunal de Paris. Ce, malgré le fait que les incidents incriminés se soient produits « entre 1986 et 1992 ».
Peut-on toujours entamer des poursuites judiciaires suite aux allégations de violences sexuelles déclarées par Judith Godrèche ? C’est une question qui mérite d’être posée alors que l’actrice a déposé une plainte pour viol sur mineur mardi, ciblant les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon. En réponse à cela, le parquet de Paris a décidé, mercredi 7 février, d’ouvrir une enquête portant entre autres sur les faits reprochés, datant entre 1986 et 1992, de viol sur mineur de 15 ans par une personne en position d’autorité.
La loi du 10 juillet 1989 a établi un délai de prescription de vingt ans, à compter du jour de la majorité de la victime, pour un viol commis sur un mineur par une personne qui a autorité sur lui. Aujourd’hui, le délai de prescription est de 30 ans, ce qui signifie jusqu’à l’âge de 48 ans. Cependant, cette loi ne s’applique pas aux infractions perpétrées avant le 6 août 2018. En adhérant au principe de non-rétroactivité, on affirme qu’on ne peut juger des actes à l’aune d’une loi adoptée après leur réalisation.
« Stimuler la remémoration des autres victimes »
« Dans de nombreux départements judiciaires, en particulier à Paris, cette façon de procéder est assez récente. Cela ne concerne pas uniquement le cas de Judith Godrèche. C’est une nouvelle orientation en matière de droit pénal »La Familia Grande,qui accusait Olivier Duhamel d’inceste sur son frère« Il faudra systématiquement ouvrir une enquête même si les faits semblent en premier lieu prescrits »cette circulaire datant du 28 mars 2023« La première visée est de découvrir si d’autres victimes existent dont les faits ne sont pas prescrits ». « Cette initiative judiciaire est intéressante car elle sert un intérêt plus large », comme le remarque Audrey Darsonville. « Publier une enquête sur ces types de faits, particulièrement traumatisants, peut aider d’autres victimes à se souvenir, ce qui pourrait être perçues comme une sorte d’amnésie », explique Isabelle Rome, ancienne ministre chargée de l’égalité homme-femme et actuelle première présidente de la cour d’appel de Versailles. Forte de son expérience aux assises, Rome, auteure récente du livre La Fin de l’impunité, soutient que cela aide à briser le silence, surtout que les victimes de violences sexuelles vivent fréquemment sous une chape de silence.
S’assurer du délai de prescription
Certains victimes ont peut-être déjà dénoncé les faits, mais leurs plaintes et témoignages n’ont jamais été rassemblés. Une enquête pourrait y remédier. Dans le même temps, les enquêteurs ont la possibilité de vérifier si d’autres actes similaires, qui sont survenus après ceux énoncés dans la plainte initiale, ont pu interrompre la prescription. Ceci correspond au principe de « la prescription glissante », introduit par la loi du 21 avril 2021 qui vise à protéger les mineurs des agressions sexuelles et de l’inceste.
D’après cette loi, le délai de prescription pour ce type de viol peut être étendu jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. En d’autres termes, si l’individu accusé a agressé sexuellement, ou a violé, un autre mineur ultérieurement, le délai de prescription pour cette nouvelle infraction sera considéré. Avec cette nouvelle disposition, l’ouverture d’une enquête peut donc se révéler être pertinente, comme l’estime Isabelle Rome, suite à l’éventuelle non-prescription des faits reprochés. Ou, du moins, cela permettra de le déterminer.
Parce que la prescription n’est pas une certitude : il faut vérifier son existence. « Les calculs pour déterminer le délai de prescription sont compliqués. Il y a toujours une chance d’erreur », note Audrey Darsonville. Encore une fois, l’enquête offre le temps nécessaire pour réaliser cet exercice.
« Renforcer la quête de vérité »
En ouvrant une enquête, la justice offre tout simplement l’opportunité de faire émerger les faits. Les personnes accusées ont l’occasion de se défendre et la voix de la victime est prise en considération. Le dépôt de plainte de cette dernière est au moins étudié de manière approfondie, voire passé au crible. « C’est une manière de lui montrer du respect, de l’écouter. Elle est entendue par le système de justice pénal », rappelle Audrey Darsonville.
Jusqu’à quel degré ? Dans son essai intitulé Eloge de la prescription, l’avocate Marie Dosé, qui représente notamment Jacques Doillon, considère cela comme une perversion de la justice qui ne sert que les victimes, surtout lorsque les procureurs annoncent à l’issue d’une enquête que les faits pourraient constituer un crime, mais qu’ils sont prescrits.
En effet, lorsque l’affaire Olivier Duhamel a été classée sans suite par le parquet de Paris en juin 2021 pour des viols et des agressions sexuelles sur mineurs par une personne ayant autorité, le procureur de l’époque, Rémy Heitz, a déclaré que « les faits révélés ou déclenchés par la procédure étaient de nature criminelle et auraient été jugés si la loi n’avait pas fixé un délai ». Marie Dosé écrit que « la prescription protège aussi les victimes en les prémunissant de faux espoirs ». Néanmoins, pour Isabelle Rome, le plus important est d’« aller en profondeur dans la recherche de la vérité, même si les faits sont prescrits », dans le but, comme elle l’explique, de rompre avec un système d’impunité.