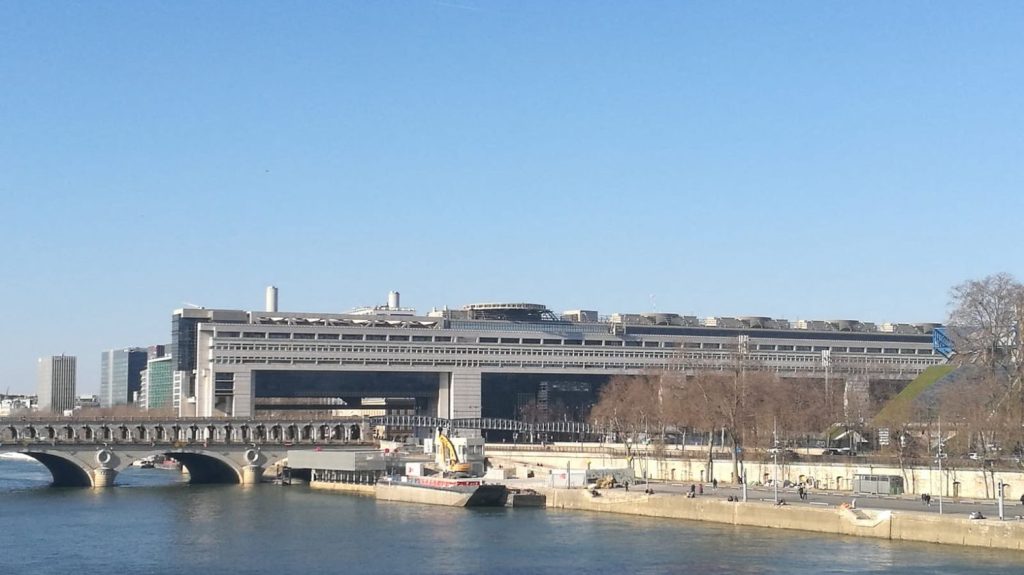Chaque samedi, l’historien Fabrice d’Almeida nous offre une nouvelle vision de l’actualité.
Cette semaine, le terme qui est sur toutes les lèvres est « déficit public ». Les dernières statistiques de l’Insee révèlent un déficit de 5,5% du PIB pour l’année 2023, un chiffre supérieur aux prévisions initiales du ministre Bruno Le Maire. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, n’a pas hésité à critiquer l’incapacité récurrente des divers gouvernements à respecter leurs promesses budgétaires.
Pour un historien, le déficit public est une notion relativement moderne. En effet, nos ancêtres les rois n’avaient pas de budget à proprement parler. Il n’y avait pas d’assemblée parlementaire devant laquelle ils devaient défendre leur gestion financière annuelle. Depuis le temps des féodaux au Moyen-Âge, le souverain était informé de ce qu’il percevait, dépensait et parfois empruntait à des banquiers pour faire face à des situations imprévues comme une guerre, un mariage royal ou une crise. C’est d’ailleurs la hausse des coûts militaires qui conduit Louis XVI à convoquer les États généraux au printemps 1789 pour des taxes plus élevées, déclenchant ainsi la Révolution.
Même pendant la Révolution et l’Empire de Napoléon Bonaparte, il n’y a pas de présentation formelle de budget. Il faut attendre le retour de la monarchie avec Louis XVIII pour que soit présente le premier budget à la Chambre des députés en 1814. A cette époque, le ministre des Finances se nommait Joseph-Dominique Louis, baron de son état. Son souhait le plus cher était de regagner la confiance après des années de conflit et d’apaiser les grandes puissances, notamment pour pouvoir assumer les lourdes pénalités de guerre que l’Europe avait infligé à la France : une somme stupéfiante de 700 millions de francs or. Pour la première fois dans l’histoire de France, le budget a été ouvertement discuté, les recettes et les dépenses étant mises sur la table. Il était désormais impératif d’équilibrer le budget, ce qui a rendu possible l’emprunt sur les marchés financiers internationaux.
Au cours du XIXe siècle, les gouvernements, en fonction des circonstances et leurs aspirations, ont été contraints d’emprunter d’importantes sommes. Sous la III e République, entre 1880 et 1914, dans un contexte de mondialisation similaire à celle que nous vivons aujourd’hui, les gouvernements ont dû emprunter pour répondre à diverses obligations financières dont le paiement des réparations exigées par l’Allemagne après la guerre de 1870, faire face à la crise économique et financer l’expansion coloniale. Il est même arrivé que les taux d’endettement atteignent des niveaux comparables à ceux d’aujourd’hui. En 1887-1889, la dette atteint 120% du PIB et ne descend pas en dessous de 110% jusqu’en 1895. Des modifications de tarifs douaniers et de prélèvements ont permis de réduire la dette qui demeurait à 60% du PIB avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. En réalité, durant presque toute cette période, on assiste à une maîtrise des dépenses, voire à des années d’excédents budgétaires. La France jouissait ainsi d’une excellente réputation pour ses emprunts à des taux de 3 ou 5%.
De Gaulle et le retour à la rigueur budgétaire
Les dépenses explosives des deux Guerres mondiales ont rendu le déficit courant. Le redressement budgétaire fut désigné par un nom : celui de De Gaulle. Lorsqu’il revient au pouvoir en 1958, il prend des mesures pour freiner la dette, mettre un terme au déficit budgétaire et contrôler l’inflation avec l’aide crucial d’Antoine Pinay qui rassure les acteurs économiques. Ce plan s’accompagne d’une réforme monétaire et la mise en place du nouveau franc après une dévaluation qui a stimulé le commerce extérieur. Georges Pompidou cherche à maintenir le cap avec des mesures de stabilisation.
C’est en 1973 que la donne change avec le choc pétrolier. Pour la première fois en 1975, le gouvernement dévoile un budget en déficit et commence à emprunter. Jacques Chirac, alors Premier ministre, préfère éviter que l’austérité freine la croissance et que les chômeurs instaurent un climat de révolte. Même ligne de conduite pour François Mitterrand en dépit des appels à la rigueur, réaffirmés par Jacques Delors à partir de 1983. Jacques Chirac revenu au pouvoir en 1995, reconnait également la nécessité d’austérité pour redresser les finances du pays. Pourtant, la situation reste inchangée.
En réalité, aucun gouvernement n’a retrouvé l’équilibre budgétaire depuis un demi-siècle. À l’instar de l’Ancien Régime, nous sommes assez laxistes sur nos comptes. L’annonce récente d’un déficit plus lourd que prévu est dans la lignée des cinq décennies précédentes. Bruno Le Maire n’a pas le même impact que le baron Louis. Il a du mal à faire de cette question cruciale une priorité politique. Comme dans beaucoup d’autres domaines, les vieilles habitudes ont la peau dure en matière de finance.