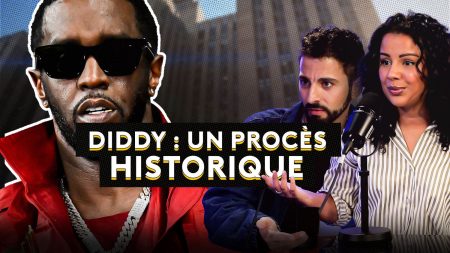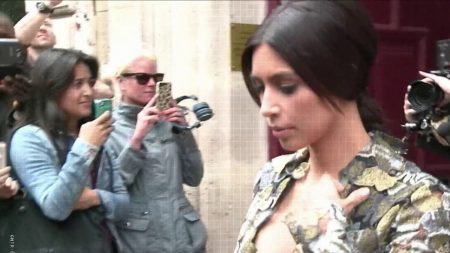Suite au décès de l’adjudant Eric Comyn, plusieurs dirigeants politiques demandent une répression accrue des comportements délictueux sur les routes, notamment en ciblant les individus qui ne se soumettent pas aux injonctions des forces de l’ordre.
Ce tragique événement a suscité une onde de choc. Eric Comyn, un gendarme âgé de 54 ans, a trouvé la mort lundi soir, percuté par un automobiliste qui tentait de fuir un contrôle à la sortie de l’autoroute A8 à Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Un homme de 39 ans a été arrêté quelques heures après les faits et mis en examen le mercredi 28 août pour « meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique ». Il a ensuite été placé en détention, selon le parquet de Grasse.
Le suspect, « en situation régulière » et possédant un permis de conduire valide, avait déjà été impliqué dans de nombreux délits routiers, y compris des refus d’obtempérer, d’après les déclarations de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur démissionnaire, sur BFMTV au lendemain du drame. Le parquet a précisé qu’il avait un casier judiciaire chargé de dix condamnations, comprenant six pour infractions routières et quatre pour atteintes aux personnes. Lors de son interpellation dans la nuit de lundi à mardi, son taux d’alcoolémie était positif.
À la suite de ce drame, plusieurs personnalités politiques réclament une répression plus sévère des délits routiers, notamment concernant les refus d’obtempérer. Le groupe de députés A Droite, dirigé par Eric Ciotti des Républicains, a annoncé sur le réseau social X la présentation imminente d’une proposition de loi visant à « durcir les sanctions contre les refus d’obtempérer ». Le maire de Mougins plaide quant à lui pour des sanctions « beaucoup plus fortes et dissuasives ».
Jusqu’à cinq ans de prison pour un refus d’obtempérer
Les tribunaux correctionnels sont chargés de juger les délits routiers, qui incluent des affaires variées comme les excès de vitesse de plus de 50 km/h, la conduite sans permis, la conduite en état d’ébriété ou sous l’influence de drogues, ainsi que les homicides et blessures involontaires. Les peines prononcées varient en fonction de la gravité des actes, et le juge décide du montant de l’amende, de la durée de suspension du permis de conduire et, le cas échéant, de la peine d’emprisonnement. En général, un délit entraîne le retrait d’au moins six points sur le permis et les amendes vont de 3 750 à 150 000 euros.
Concernant le refus d’obtempérer, une loi du 24 janvier 2022 a renforcé les sanctions : deux ans de prison, 15 000 euros d’amende, et la suspension du permis de conduire selon l’article L233-1 du Code de la route. Si ce délit est commis avec mise en danger de la vie d’autrui, les peines sont aggravées à cinq ans de prison, 75 000 euros d’amende et la suspension du permis. En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.
« Vers plus de fermeté »
« La législation est stricte et permet aux juges d’agir fermement », selon Michel Benezra, avocat spécialiste en droit routier. Il constate une réelle fermeté dans les tribunaux, notamment en cas de récidive pour conduite sous alcool ou stupéfiants, où « l’annulation du permis est systématique, indépendamment du nombre de points restants sur le permis. Cela constitue une peine ‘plancher’, c’est-à-dire automatique ».
Franck Cohen, autre avocat spécialisé en droit routier, partage ce constat : « On observe un durcissement, surtout lorsque le prévenu a déjà été averti par les autorités judiciaires ». Toutefois, Cohen souligne l’importance pour les juges de personnaliser les peines en tenant compte du contexte personnel, professionnel et familial du prévenu, ainsi que de son casier judiciaire et de l’existence éventuelle d’infractions précédentes.
Interrogé par France 3 Provence-Alpes Côte d’Azur, Olivier Grebille-Romand, avocat, rappelle que les délits routiers sont souvent associés à une forte récidive. « L’alcool, par exemple, fait partie des habitudes quotidiennes. Deux contrôles positifs en cinq ans, et on devient récidiviste », précise-t-il.
Pour désengorger les tribunaux débordés, notamment par les délits routiers, les magistrats optent souvent pour des alternatives pénales telles que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), ou « plaider-coupable ». Cette procédure permet de juger plus rapidement, à condition que le prévenu reconnaisse les faits reprochés, comme l’explique service-public.fr.
De la prison pour les cas les plus graves
Cependant, cette procédure n’est pas applicable aux délits les plus graves, comme les homicides involontaires, qui sont jugés lors d’audiences au tribunal, où « il y aura systématiquement de la prison ferme », affirme Michel Benezra. Franck Cohen ajoute qu' »un magistrat n’hésitera pas à imposer une peine de prison si les infractions multiples rendent les faits quasi inéluctables ». Par exemple, un conducteur sous l’emprise de l’alcool, utilisant son téléphone et commettant un excès de vitesse significatif pourrait être incarcéré, au moins jusqu’à son procès.
Au global, les délits routiers en France ne mènent que rarement à des incarcérations. « Les prisons sont remplies de personnes condamnées pour des actes violents nécessitant une intentionnalité, comme les braquages, viols et assassinats. La justice préfère souvent emprisonner ces individus », note Michel Benezra. Le nombre de détenus en France continue d’augmenter, atteignant un record de 78 509 personnes incarcérées au 1er juillet, selon les chiffres du ministère de la Justice.
Concernant l’augmentation des refus d’obtempérer, Franck Cohen, souvent sollicité pour ce type de délits, reconnaît une « véritable problématique ». « La répression a durci certains délits, avec des retraits de points sur les permis. Beaucoup de conducteurs, craignant la suspension de leur permis, prennent alors des risques insensés pour échapper à un contrôle, aggravant ainsi leur situation », indique Franck Cohen. Gérald Darmanin a rappelé sur BFMTV qu’il y a en moyenne « 25 000 refus d’obtempérer par an », dont « 5 000 directement liés à des policiers, gendarmes ou citoyens ».