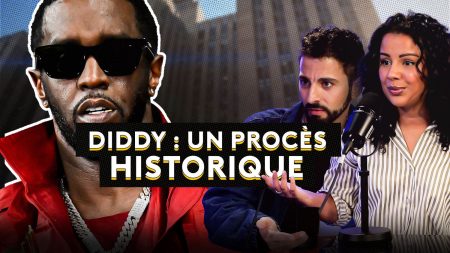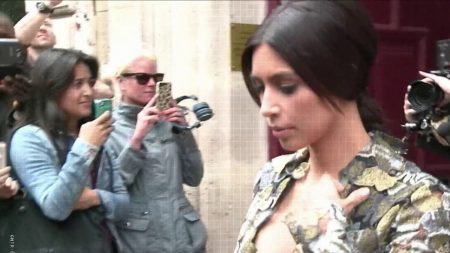Mercredi, lors de la troisième audition de Gisèle Pelicot dans le cadre du procès des viols survenus à Mazan, la question du consentement et son inclusion dans le Code pénal suscite à nouveau des discussions dans l’espace public. Les points de vue divergent fortement sur ce sujet.
La Révision de la Notion du Viol : Une Question Épineuse au Cœur du Procès de Mazan
Dès le début de septembre, le procès concernant les viols de Mazan a ravivé le débat concernant la manière dont le viol est défini dans le Code pénal français. Le 27 septembre, sur les ondes de France Inter, Didier Migaud, alors garde des Sceaux, a exprimé son souhait de voir la notion de consentement intégrée au Code pénal. Cependant, il n’a fourni aucun détail précis sur la façon dont une telle modification pourrait être mise en œuvre. Auparavant, lors de la journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron avait également montré son soutien à cette évolution. L’idée d’introduire le consentement dans la législation divise profondément féministes, juristes et politiciens.
L’actuel article 222-23 du Code pénal stipule que tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature, ou tout acte bucco-génital réalisé sous l’effet de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, constitue un viol. Toutefois, l’article ne fait aucune mention explicite du consentement de la victime.
En parallèle, la France a ratifié la Convention d’Istanbul, une initiative du Conseil de l’Europe destinée à améliorer la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et la violence domestique. Cette convention définit le viol comme un acte dépourvu de consentement. De nombreux pays occidentaux, signataires de cette convention, ont adapté leurs lois pour y inclure le critère de non-consentement, parmi lesquels la Belgique, le Canada, et d’autres. Cependant, la France n’a pas encore opéré ce changement, et la question du consentement demeure controversée.
Le Consentement : Une Notion à Traiter avec Prudence
À Mazan, lors du procès, la simple mention de la modification légale suscite des réactions vives et variées, y compris parmi les avocats des deux parties. Me Louis-Alain Lemaire, avocat à Avignon, représentant plusieurs accusés dans cette affaire, s’oppose fermement à l’introduction de la notion de consentement. Il souligne que cette modification pourrait bouleverser les principes fondamentaux du droit pénal français, où il incombe traditionnellement au procureur de démontrer le crime ou le délit, prouvant à la fois l’acte matériel et l’intention. Selon lui, intégrer la notion de consentement inverserait la charge de la preuve, obligerait l’accusé à prouver qu’il avait obtenu le consentement, et menacerait ainsi la présomption d’innocence.
Pour des raisons divergentes, Me Antoine Camus, qui représente Gisèle Pelicot, exprime également des réserves. Il explique que le consentement peut être donné sous pression, pour des raisons variées comme éviter un harcèlement persistant ou conserver un emploi. Il craint que cette modification puisse se retourner contre les victimes elles-mêmes. De plus, il s’interroge sur la complexité de déterminer précisément à quel acte sexuel le consentement s’applique, mettant en garde contre le potentiel piégeux de cette notion dans le domaine juridique actuel.
Par ailleurs, certaines associations, telles qu’Osez le Féminisme, rejettent l’idée de modifier la loi sur le viol. Elles considèrent le viol non comme une simple question de relation sexuelle non consentie, mais comme un acte de domination et de contrôle. Ces groupes dénoncent le fait que placer le consentement au centre de la législation pourrait conduire à un examen minutieux et injuste de la conduite de la victime plutôt que de rappeler l’importance de se concentrer sur les actions de l’agresseur.
Des Statistiques Alarmantes et un Appel au Changement
Toute réforme législative future nécessitera une formulation précise et prudente. Si Didier Migaud envisage un projet, chaque terme devra être soigneusement choisi, et les débats parlementaires qui s’ensuivront seront probablement intenses et largement médiatisés.
Les partisans de la réforme soulignent un constat préoccupant : une étude publiée par l’Institut des politiques publiques indique que 94 % des plaintes pour viol, entre 2012 et 2021, sont classées sans suite. Si ce problème est partiellement attribué au manque de ressources et de formation des enquêteurs, Mélanie Vogel, sénatrice écologiste, souligne que la rédaction actuelle du Code pénal sous-entend une présomption de consentement tant qu’il n’a pas été prouvé le contraire par contraintes spécifiques.
Mélanie Vogel plaide pour une inversion de cette logique : selon elle, le corps doit être considéré par défaut comme indisponible, sauf preuve de consentement clair à un acte sexuel. Elle soutient que la loi doit non seulement augmenter le nombre de condamnations, mais aussi dissuader les viols en augmentant le risque de sanctions pour les agresseurs. Une telle évolution législative refléterait aussi les valeurs fondamentales de respect et de protection au sein de la société.
Changer les Comportements Sociétaux
Les partisans de cette réforme estiment qu’un renforcement juridique pourrait influencer positivement les comportements, à l’image des mesures qui ont réduit de moitié le nombre de décès liés aux accidents de la route durant les années 2000, suite à des campagnes de sensibilisation et à des lois plus strictes.
Magali Lafourcade, ancienne juge d’instruction, estime que l’intégration de la notion de consentement dans la loi rééquilibrerait le processus d’enquête, transférant davantage l’accent sur le comportement de l’accusé. Elle considère que cette modification pourrait alléger la pression pesant sur les victimes, souvent découragées de porter plainte par anticipation des difficultés et souffrances qu’impose cette démarche.
Tout en reconnaissant les critiques, estimant que cette réforme pourrait nous amener vers une société où un consentement écrit deviendrait la norme, Lafourcade insiste sur le fait que la présomption d’innocence demeure un pilier central du système judiciaire, où le moindre doute profite toujours à l’accusé.