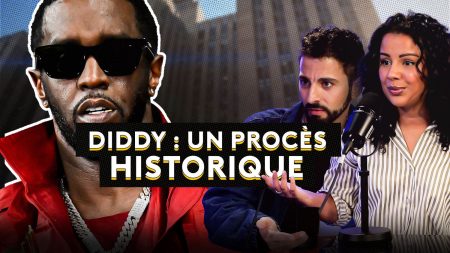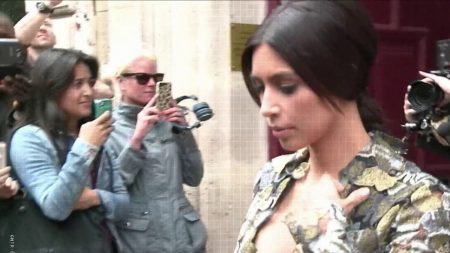L’ex-collaborateur professionnel d’Éric Dupond-Moretti se trouve actuellement impliqué dans une affaire examinée par le conseil de discipline du Barreau de Paris. Les accusations concernent des comportements présumés de harcèlement psychologique et sexuel. Parallèlement à cette procédure disciplinaire, une enquête pénale est en cours à son encontre, à la suite du dépôt de trois plaintes le visant.
Un quotidien infernal abordé par les anciens collègues
Dans les témoignages recueillis, plusieurs collaborateurs du prestigieux cabinet d’avocats dépeignent une atmosphère de travail toxique. Des employés, tant des stagiaires que des salariés, se disent avoir été victimes d’humiliation, de dénigrement et de harcèlement de la part de leur supérieur, Antoine Vey.
Ce pénaliste, reconnu pour la défense de figures notoires comme Julian Assange, Patrick Balkany et le frère de Mohamed Merah, était l’associé choisi par Eric Dupond-Moretti en 2016 et avait pris la tête du cabinet après que ce dernier ait été nommé ministre de la Justice.
Aujourd’hui âgé de 40 ans, Antoine Vey est suspecté de comportements pouvant être qualifiés de harcèlement moral et sexuel, selon les révélations de Libération en mars 2023. Des anciens employés ont confié à Franceinfo leur expérience, des récits souvent accompagnés de démissions, de saisines de l’Ordre des avocats et, dans de plus rares cas, de plaintes judiciaires. Les documents consultés par Franceinfo révèlent un cadre professionnel décrit par un ex-collaborateur comme « un lieu de chaos ».
« Quelle nouvelle réprimande vais-je recevoir ? »
Une avocate, ayant travaillé il y a sept ans avec Antoine Vey, évoque l’anxiété grandissante dès qu’un message du pénaliste était reçu. Elle se souvient des brimades, des humiliations et du contrôle permanent exercé par l’avocat. « Rien que voir un message apparaître déclenchait une angoisse : ‘Qu’est-ce qui va encore tomber sur moi ? Quels changements d’instructions vais-je devoir subir ?' ».
Elle avait rejoint le cabinet en 2017, après un événement tragique dans sa vie personnelle, et se retrouva à réaliser des tâches ayant peu à voir avec son expérience de vingt ans. La charge de tâches administratives, jugée dégradante, l’a poussée à quitter le cabinet après neufs mois à cause de l’épuisement physique et de l’inquiétude de son entourage. Une hospitalisation psychiatrique a marqué la fin de cette période, résultant d’un épuisement intense.
D’autres anciens collaborateurs partagent également leur détérioration physique et émotionnelle durant leur passage au cabinet, mentionnant la nécessité de médicaments pour pouvoir dormir et une perte de poids marquée.
Le système d’humiliation, d’après eux, était établi comme une règle de conduite. La « théorie de l’élastique », souvent citée dans les témoignages, reflétait une pression continue, Antoine Vey se concentrant sur un employé jusqu’à ce que celui-ci soit au bord du craquage.
« Chacun de nous pouvait devenir à tout moment l’objet de sa colère. Il passait de l’un à l’autre, déversant frustrations et colère jusqu’à ce que nous soyons prêts à rompre. »
une avocatedans son rapport à l’Ordre des avocats
Ces humiliations étaient souvent pratiquées en public, lors des réunions répétitives convoquées par Antoine Vey, où des documents étaient souvent critiqués devant tous les présents, reproduisant une ambiance de stress collectif. Cette crainte du jugement constant laissait les avocats avec un manque de confiance en eux, rendant difficile leur départ du cabinet.
Disponibilité totale requise
Les demandes incessantes venant s’ajouter aux humiliations, plusieurs témoignages concordent sur la nécessité d’être constamment joignable, des appels et messages incessants s’étendant de l’aube jusque tard dans la nuit. Une ancienne stagiaire rapporte avoir été prévenue dès son embauche de la nécessité d’être disponible jour et nuit. Même les périodes de congé ou les moments personnels n’échappaient pas à cette exigence de réactivité.
Durant les jours fériés, le volume de travail ne fléchissait pas, amplifiant le sentiment de malaise et les discussions entre collègues sur la charge ininterrompue de travail. Ces harcèlements constant favorisent un stress persistant, touchant même ceux en arrêt maladie et incluant des demandes à visée personnelle pour l’avocat.
Tâches inappropriées et abus : au-delà de la fonction légale
Les tâches réclamées par Antoine Vey dépassaient souvent les obligations professionnelles normales. Du simple achat d’une brosse à dents aux courses personnelles comme récupérer ses vêtements et accomplir des tâches domestiques, les avocats se retrouvaient souvent à accomplir des missions personnelles jugées impropres à leur rôle, contribuant à un climat de déshumanisation. Un collaborateur, estimant les missions imposées comme rabaissantes, évoque les répercussions négatives sur sa vie privée et familiale.
Réactions indignées et luttes contre le harcèlement
À ces conditions de travail asphyxiantes, s’ajoutent des comportements que des avocats qualifient de sexistes et de harcèlements sexuels. Une ancienne collaboratrice affirme avoir été victime de gestes inappropriés et de remarques misogynes dans un cadre prétendument professionnel. Elle raconte avoir confronté Antoine Vey, au cours d’une rencontre en déplacement, sur ses comportements déplacés. Ses reproches fréquents et ses gestes intrusifs exacerbent un climat déjà tendu.
Elle témoigne également des propos menaçants et provocateurs d’Antoine Vey à son égard, les commentaires vulgaires et le mépris qu’elle subissait continuant de la hanter bien après son départ de l’entreprise, provoquant encore aujourd’hui un stress intense à l’évocation ou à la rencontre de l’avocat.
Antoine Vey, par l’intermédiaire de son avocat Me Emmanuel Marsigny, nie catégoriquement les accusations mentionnées, arguant que seules quelques anecdotes ressortent d’une décennie d’activité du cabinet et interprétant ces récits sous le prisme d’une exigence professionnelle mal supportée par les jeunes avocats concernés.
Une audience, reportée à la demande de l’avocat d’Antoine Vey, menace des sanctions sévères pour l’accusé si les faits sont avérés.