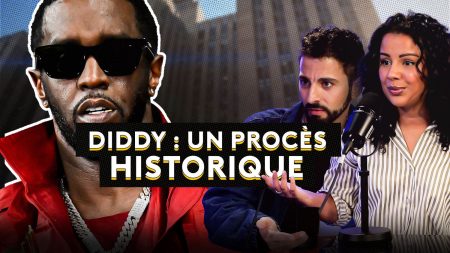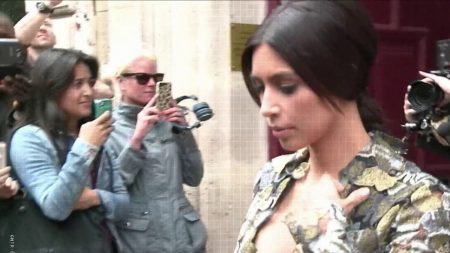Mercredi, les discussions ont débuté à l’Assemblée nationale concernant un projet de loi introduit par Gabriel Attal visant à renforcer les mesures dans le système judiciaire des mineurs. L’ancien Premier ministre soutient cette initiative en évoquant une différence significative entre les jeunes d’aujourd’hui et ceux de la période d’après-guerre, arguant que « le mineur de 2025 est distinct de celui de 1945 ».
« Prenons en compte que le jeune de 2025 ne ressemble pas au jeune de 1945. » C’est avec cette phrase, répétée dans différentes interviews, que le député macroniste et ancien Premier ministre Gabriel Attal justifie sa proposition de loi visant à rendre la justice pour mineurs plus stricte. Cette loi, dont l’examen a commencé le mercredi 12 février à l’Assemblée nationale, propose de réformer une justice basée sur une ordonnance datant de 1945, mise en place peu après la Seconde Guerre mondiale. Selon Gabriel Attal, « nous avons observé ces dernières années une violence accrue chez les jeunes. »
Il est vrai que la délinquance juvénile a augmenté depuis 1945, d’après les recherches du Vrai ou Faux. Pour étayer cette affirmation, il était nécessaire d’explorer les archives du ministère de la Justice en analysant les rapports de la Direction de l’éducation surveillée, créés juste après la guerre, disponibles en ligne sur criminocorpus.org.
Une délinquance juvénile doublée entre 1945 et 2023
Le premier rapport concernant la délinquance des jeunes a été remis au ministre de la Justice en 1947, suivi d’un second en 1948, contenant des données pour l’année 1945. Il est mentionné que cette année-là, 17 578 jeunes ont été jugés en France.
Comment peut-on comparer cela avec la situation actuelle ? Le chiffre de 1945 se limite aux jeunes impliqués dans des affaires jugées, excluant ceux qui ont reçu une admonestation avant jugement ou dont les enquêtes ont été classées sans suite ou ont abouti à un non-lieu. Cela semble correspondre à la notion de « mineurs poursuivis » des rapports récents du ministère de la Justice, excluant donc les classements et les alternatives aux poursuites. En 2023, selon les dernières données disponibles, 48 389 jeunes ont été poursuivis par la justice en France.
Cependant, on ne peut comparer directement les 17 578 de 1945 aux 48 389 de 2023, car cela négligerait l’énorme changement démographique qu’a connu la France en presque un siècle. Pour ajuster ces données, il est nécessaire de consulter les archives de l’Institut national d’études démographiques (Ined), qui offrent une série de données permettant de calculer le nombre de jeunes dans la population générale en 1945 et en 2023. Néanmoins, ces données présentent une limitation : elles concernent les 0-19 ans et non exclusivement les moins de 18 ans. Bien que ce ne soit pas parfait, c’est le seul moyen de faire une comparaison valable entre les deux époques.
Après avoir calculé le nombre de jeunes dans la population totale en 1945 et en 2023, on constate que les mineurs jugés représentaient 15 jeunes pour 10 000 en 1945, tandis que les mineurs poursuivis représentaient 32 pour 10 000 en 2023. En d’autres termes, les jeunes d’aujourd’hui sont deux fois plus souvent traduits en justice que ceux de 1945.
Mais peut-on dire que les jeunes d’aujourd’hui sont plus violents ? Pour répondre à cette question, il faut remonter quelques années dans les archives. Le premier rapport fournissant des statistiques détaillées sur les infractions commises par les jeunes a été publié en 1953, portant sur l’année 1952. Cette année-là, 12 % des infractions attribuées aux jeunes visaient des personnes, 67 % concernaient des biens, et 8 % étaient « contre les mœurs ».
En 2023, les choses sont présentées différemment, mais en réunissant les coups et violences avec les viols et agressions sexuelles, il ressort que 30 % des infractions reprochées aux jeunes étaient dirigées contre des personnes. En somme, la violence physique observée chez les jeunes a été triplée entre 1952 et 2023.
Un durcissement progressif de la justice des mineurs
Il est important de noter également que la sévérité de la justice des mineurs a suivi une évolution similaire. Si la violence physique des jeunes a triplé, l’aptitude de la justice à les condamner à des peines de prison ou à des amendes a également triplé. En 1952, 10 % des jeunes jugés étaient condamnés à des peines de prison ou à des amendes, les autres bénéficiant quasiment intégralement de mesures éducatives. En 2023, près de 30 % des jeunes poursuivis ont été condamnés.
Cette hausse de la proportion des peines montre un durcissement du système judiciaire. Dans le premier rapport de 1947, la Direction de l’Éducation surveillée déclarait : « En principe, il n’existe pas d’enfance coupable, mais seulement des enfants et adolescents victimes de leur famille, de leur milieu ou de l’hérédité, à protéger, rééduquer et réadapter à la vie sociale. Par conséquent, les notions de délit et de peine, sur lesquelles repose le droit pénal, ne doivent pas s’appliquer aux mineurs. Autrement dit, il ne devrait pas y avoir, normalement, de responsabilité pénale du mineur. » C’est dans cet esprit que l’ordonnance du 2 février 1945 sur la justice des mineurs considérait que « un mineur de moins de 18 ans est présumé pénalement irresponsable ».
Néanmoins, la justice s’est peu à peu écartée de l’esprit de 1945. D’une part, à cause de l’adoption d’une trentaine de réformes législatives sur la justice des mineurs, créant de nouveaux délits et de nouvelles peines. D’autre part, parce que « l’exception [est devenue] la règle », comme l’observe l’historien Jean-Jacques Yvorel dans un article intitulé « 1945-1988 : Histoire de la justice des mineurs », publié dans les Cahiers Dynamiques en 2015.
Les caractéristiques particulières de 1945
« La priorité accordée à la mesure éducative sur la peine est l’essence de la ‘philosophie’ de la justice pour mineurs. Vous auriez du mal à trouver un juge pour enfants qui prétendrait le contraire, » écrit-il. « Pourtant, en 1954, les tribunaux pour enfants prononcent 1 377 peines (prisons et amendes avec ou sans sursis) et 11 140 mesures, soit un pourcentage de peines qui atteint 10,2 %. En 1979, ces même tribunaux prononcent 19 630 condamnations pénales pour 40 589 mesures éducatives, soit 32,6 % de peines. En 2013, les juridictions pour mineurs ont prononcé 22 702 peines et 22 634 mesures, décisions auxquelles il convient d’ajouter 1 732 sanctions éducatives et 1 472 dispenses de peine. L’exception devient la règle ! »
Il existe plusieurs autres éléments qui nuancent la comparaison entre 1945 et aujourd’hui. Notamment, le fait que l’année 1945 a été marquée par une diminution de la délinquance juvénile, expliquée en partie par la désorganisation des services judiciaires et policiers à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme l’indique la Direction de l’Éducation surveillée dans son rapport de 1948.
« Il est à noter que le nombre de mineurs traduits devant les tribunaux est encore inférieur au nombre réel de délinquants, dont beaucoup ne sont pas inquiétés, faute de moyens policiers (la brigade de la voie publique du service de protection des mineurs de la préfecture de police, par exemple, ne comporte que huit inspecteurs, et il y a très peu d’assistants de police) », précise le document. La Direction de l’Éducation surveillée estime par ailleurs que les forces de l’ordre peuvent faire preuve de clémence envers les jeunes délinquants, les laissant souvent repartir après un avertissement. Les juges, dans la même veine, adoptaient fréquemment la même attitude.