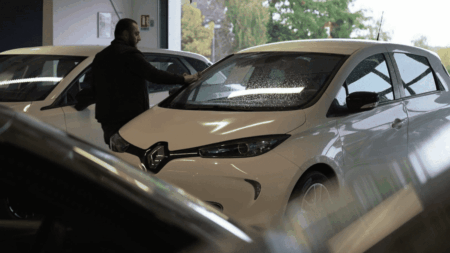Malgré la situation économique tendue et les défis mondiaux actuels, Dorothée Rouzet, de la direction générale du Trésor, souligne l’importance de penser à la proportion entre les secteurs privé et public concernant le futur massif des investissements à venir. Elle insiste sur le fait que, bien que la transition engage des coûts, ceux-ci demeurent raisonnables et temporaires.
Comment équilibrer économie de guerre, réduction carbone et sobriété budgétaire ?
La France, ainsi que tous les autres pays de l’Union Européenne, ambitionne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030 pour parvenir à une neutralité carbone en 2050. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, d’importantes contributions financières tant du secteur public que privé sont nécessaires, estimées à 110 milliards d’euros supplémentaires chaque année d’ici 2030.
Dorothée Rouzet, principale économiste à la direction générale du Trésor, dépendance du ministère des Finances, conseille le gouvernement sur les politiques économiques. Récemment, elle a organisé et participé à une table ronde sur le thème : « Comment financer la transition écologique malgré des contraintes budgétaires ? » Elle partage donc son point de vue.
42mag.fr : Est-il encore envisageable de financer la transition écologique avec nos contraintes budgétaires ?
Dorothée Rouzet : Absolument, c’est faisable et nécessaire. Toutefois, cela implique de faire des choix avisés concernant les moyens et les outils. Il est essentiel de déterminer ce qui relèvera des financements publics et ce qui incombera au privé, surtout face à l’immensité des investissements requis.
Quelles sont les principales données à garder à l’esprit, face aux défis de la consolidation budgétaire qui se chiffrent aussi bien que ceux de la décarbonation ?
Il est crucial d’estimer les besoins en investissements pour la décarbonation d’ici 2030, avec l’objectif de réduire nos émissions de moitié par rapport à 1990. Selon nos calculs, cela nécessiterait 110 milliards d’euros d’investissements additionnels, couvrant les logements, les transports, l’industrie, et l’énergie. Cependant, certaines dépenses en énergies fossiles pourraient diminuer, notamment avec la transition vers des véhicules électriques. Ainsi, en net, l’exigence serait de 63 milliards d’euros, soit environ deux points du PIB supplémentaires en investissements publics et privés.
Comment peut-on concilier la transition écologique avec la réduction du déficit public, s’élevant à 3% du PIB en 2029 ?
La réponse naturelle est que l’État devra jouer un rôle de catalyseur pour ces investissements. Cependant, son rôle ne se limite pas aux dépenses publiques, des règlements peuvent être instaurés, tout comme l’application d’une tarification du carbone. Nous devons analyser minutieusement les effets économiques, sociaux et environnementaux de ces mesures afin de les combiner de manière optimale. Le secteur privé sera inévitablement le principal financeur de ces changements, en raison de son rôle majoritaire dans l’économie.
Quelles stratégies favoriser pour inciter le secteur privé à investir dans cette transition ?
Différentes stratégies existent. Réglementer peut parfois encourager les actionnaires privés, comme imposer aux entreprises de convertir leurs flottes automobiles professionnelles à l’électrique. Ce changement, bien que contraignant, n’est pas insurmontable pour les entreprises qui renouvellent souvent leurs véhicules. Les économistes apprécient également la mise en place d’un prix pour le carbone, avec des systèmes de quotas d’émissions européens en place, bien qu’ils posent des défis d’acceptabilité sociale. Enfin, diverses aides publiques, comme des subventions ou garanties, pourront être mobilisées pour épauler ces efforts, en particulier lorsque les obstacles sont davantage financiers que liés à la rentabilité propre.
Comment veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte ?
C’est là tout l’enjeu de l’accompagnement. L’État doit prendre l’initiative de ces investissements, qu’ils concernent la rénovation des bâtiments publics ou le développement d’infrastructures bas-carbone. L’accompagnement des ménages et des entreprises est également primordial, surtout pour les plus vulnérables ou éloignés des transports publics. Il ne suffit pas d’exiger un changement de véhicule pour ceux qui en manquent les moyens ; il faut les soutenir financièrement. Les entreprises doivent également être soutenues, surtout celles risquant une perte de compétitivité menaçant leur survie face à une décarbonation forcée.
Dans le budget 2025, plusieurs réductions dans des programmes, comme le bonus écologique ou MaPrimeRénov’, posent-elles problème ?
L’analyse des budgets annuels inclut ce qu’on appelle le budget vert, évaluant la part favorable à l’environnement contre celle des dépenses polluantes. Il est prévu de maintenir l’investissement vert à 40 milliards d’euros, en hausse par rapport aux 34 milliards de 2023. Pour optimiser l’utilisation de chaque fonds public, des ajustements sont effectués : si certaines aides, comme avec MaPrimeRénov’, ne trouvent pas preneurs, il convient de réorienter ces fonds pour une efficacité accrue économiquement, socialement et écologiquement.
Les finances publiques risquent de subir des pertes de recettes avec les ambitions de sobriété carbone. Comment y faire face ?
Effectivement, une réduction des recettes est inévitable, ce qui est, en quelque sorte, une avancée positive. La fiscalité écologique, destinée à s’éteindre, vise à décourager certaines consommations. Avec un passage massivement attendu vers le véhicule électrique, un déficit budgétaire de 10 milliards d’euros d’ici 2030 est anticipé, qui pourrait atteindre 30 milliards d’ici 2050, lorsque les véhicules thermiques auront disparu ainsi que les taxes sur leurs carburants.
Quel est le prix à payer si nous choisissons l’inaction ?
Il faut retenir que le coût de l’inaction est largement supérieur à celui de l’action. Bien que la transition vienne avec un coût, estimé entre 0,5 et un point de PIB d’ici 2030, il reste temporaire. Une fois la décarbonation réussie, la croissance peut reprendre son cours. En revanche, l’inaction, selon les banques centrales mondiales, pourrait entraîner en 2050 des pertes économiques équivalentes à 15 points de PIB, en raison des impacts du réchauffement clima-tique, trois degrés de plus coûtant bien plus cher que notre effort actuel.