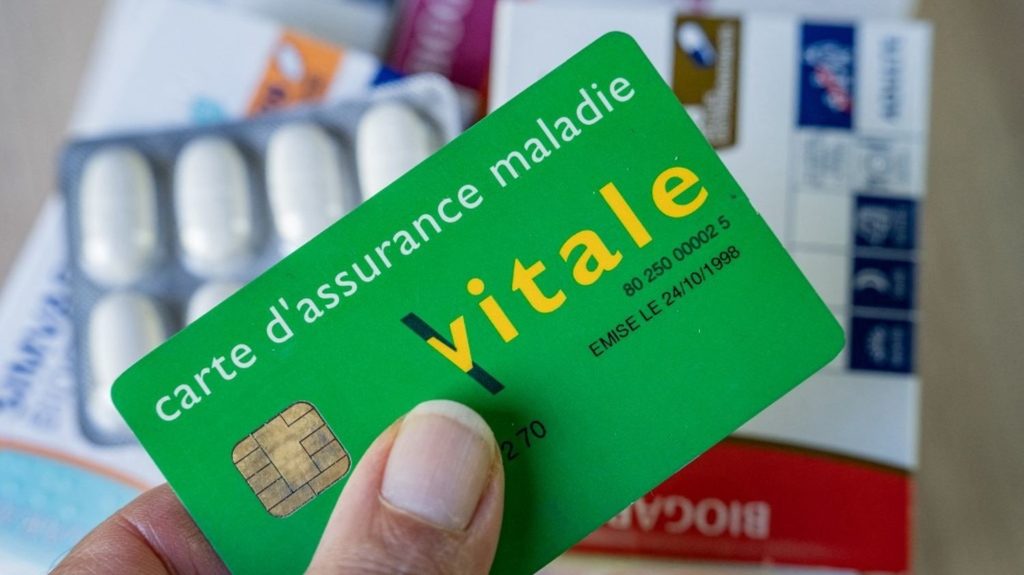Bien que le chef du gouvernement ambitionne de diminuer les coûts liés à la santé, cette hausse s’inscrit dans une tendance profonde, résultant notamment de la diminution du taux de chômage et du vieillissement progressif de la population en âge de travailler.
Les arrêts maladie sous l’œil vigilant du gouvernement. Dans le cadre de son projet visant à réduire les dépenses de santé pour atteindre 5,5 milliards d’euros d’économies et ainsi maîtriser le déficit public, le Premier ministre place les arrêts de travail dans sa ligne de mire, qu’il considère comme une forme de « dérive ». Dans un entretien accordé à Le Monde le samedi 26 juillet, la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, a aussi réaffirmé la détermination de l’exécutif à « lutter contre les abus » concernant les arrêts maladie. Mais quelle est réellement l’ampleur de cette augmentation du nombre d’arrêts de travail ?
Pour en avoir une idée précise, il convient de se référer à une étude parue en décembre 2024, réalisée conjointement par le service ministériel de la statistique en charge de la santé et du social (la Drees) et la Caisse nationale de l’assurance maladie. Ce rapport analyse à la fois le volume et le coût des arrêts maladie des salariés du secteur privé ainsi que des agents contractuels de la fonction publique, soit environ 21 millions de personnes. Les chiffres révélés confirment clairement une dynamique générale à la hausse. Comparativement à 2010, le nombre d’arrêt est passé de 6,43 millions à 8,42 millions, soit une progression de plus de 30 %, entraînant un coût global de 10,2 milliards d’euros en 2023.
Ces statistiques dévoilent une véritable explosion du nombre de congés maladie entre 2019 et 2023, phénomène particulièrement accentué chez les jeunes travailleurs, selon les chercheurs associés à l’étude. Néanmoins, cette accélération observée durant ces dernières années s’inscrit dans une tendance haussière qui avait déjà commencé avant la crise sanitaire liée au Covid-19.
Une activité accrue chez les seniors
Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer cette augmentation générale. En premier lieu, la croissance de la population active depuis 2010 a logiquement influé sur le nombre total d’arrêts de travail. L’étude précise ainsi que le nombre de salariés a augmenté « deux fois plus rapidement au cours des dernières années (+1,5 % par an entre 2019 et 2023) par rapport à la période précédente (+0,8 % par an entre 2010 et 2019) ». Autre cause significative : le vieillissement de la population active, sachant que la durée des arrêts tend à s’allonger avec l’avancée en âge. Ce phénomène est renforcé par la montée en emploi des personnes âgées de 55 à 64 ans, conséquence directe des différentes réformes des retraites qui ont repoussé l’âge légal de départ ou allongé la durée de cotisation (en 1993, 2003, 2010, 2014 et 2023).
Ces transformations démographiques couplées à l’augmentation des salaires liée à l’inflation sont considérées comme des facteurs majeurs dans la montée des dépenses liées aux congés maladie. Selon les auteurs du rapport, « l’impact direct des évolutions économiques (amplification des salaires) et démographiques représente environ 60 % de la croissance des dépenses [d’indemnités journalières] liées à la maladie entre 2010 et 2023″. Quant aux 40 % restants, plusieurs raisons sont avancées, à commencer par une augmentation de la sinistralité, c’est-à-dire la fréquence répétée des accidents ou incidents de santé, bien que ce soit « un phénomène difficile à expliquer clairement ». La Drees suggère également que la détérioration des conditions de travail pourrait jouer un rôle important dans ce contexte. Enfin, les arrêts injustifiés seraient une hypothèse partielle pour rendre compte de cette hausse, mais seulement « dans une certaine mesure ».