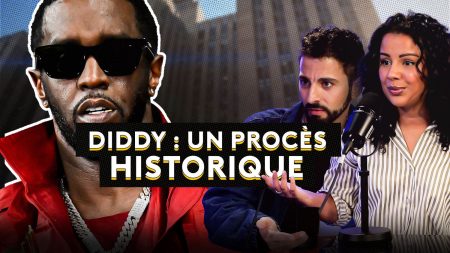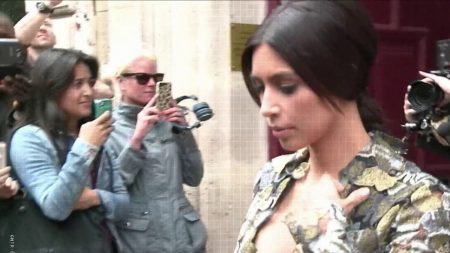Ce jeudi, une proposition de loi portée par Gabriel Attal, qui vise à rendre la justice pour mineurs plus stricte, a été approuvée en première lecture par les députés. Le Sénat devrait maintenant se pencher sur ce texte à la fin du mois de mars.
En réaction aux violences urbaines déclenchées après le décès de Nahel à l’été 2023, les députés ont approuvé en première lecture, le jeudi 13 février, une proposition de loi déposée par Gabriel Attal visant à rendre plus sévère la justice pour les mineurs. Ce texte, soutenu par le gouvernement ainsi que par la droite et l’extrême droite, a été vivement critiqué par la gauche. Il reprend certaines mesures annoncées plus tôt par l’ancien Premier ministre au printemps.
Il est possible que le texte subisse un durcissement lors de son passage au Sénat prévu pour le 25 mars. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a exprimé dans le Parisien son souhait de « déclencher le débat sur la réduction de la majorité pénale à 16 ans ». Il propose aussi de recourir à des jurés populaires pour juger des mineurs, d’instaurer un couvre-feu judiciaire pour les mineurs délinquants « après les cours et durant les week-ends », et de renforcer l’emploi du bracelet électronique pour ces jeunes.
Franceinfo analyse les éléments principaux de la proposition de loi adoptée à l’Assemblée.
Jugement immédiat pour les mineurs de plus de 16 ans
L’Assemblée nationale a réintroduit diverses mesures écartées lors de l’examen en commission fin novembre. Notamment, elle a validé la mise en place d’une procédure de jugement immédiat pour les mineurs, permettant un jugement juste après la garde à vue. Actuellement, un mineur est jugé dans un délai maximum de trois mois après une garde à vue pour établir sa culpabilité. Une seconde audience pour déterminer la sanction survient au plus tard neuf mois après.
Durant cet intervalle, l’adolescent peut rencontrer un suivi éducatif, être interdit de contact avec la victime, ou même être placé en détention provisoire. Une procédure urgente appelée « audience unique » existe néanmoins, permettant de juger et de sanctionner le mineur en une seule audience, surtout s’il est déjà connu des autorités judiciaires.
La majorité présidentielle critique cette organisation en deux temps, estimant que le délai entre l’acte et le jugement peut « accroître le sentiment d’impunité chez les jeunes », selon Gabriel Attal. L’objectif est d’« offrir une procédure rapide aux magistrats lorsque la gravité des faits et le profil du mineur le justifient », selon le texte. L’article 4 précise que cela concernerait les mineurs de plus de 16 ans, déjà connus de la justice, et nécessitant une détention provisoire.
Si elle est acceptée, cette procédure de comparution immédiate pour les mineurs ne serait pas une première. Elle existait jusqu’en 2021, date à laquelle elle a été modifiée dans le cadre de la réforme de la justice pénale des mineurs. À cette époque, le principe d’audiences séparées permettant un jugement rapide pour certains mineurs était jugé « suffisant pour garantir une réponse pénale rapide », selon Agnès Canayer, anciennes rapporteuse de la réforme, à Public Sénat.
Certains professionnels de la justice estiment que le texte de Gabriel Attal ne propose pas de véritable innovation et soulignent surtout le manque de moyens pour mettre en pratique ce qui est déjà existant. Ils craignent aussi la suppression possible du suivi éducatif entre les deux audiences, qui est, d’après eux, crucial pour sensibiliser les jeunes à la gravité de leurs actions.
Abolition de l’excuse de minorité automatique après 16 ans
L’article 5 modifie le principe d’atténuation de la peine, également connu sous le nom « d’excuse de minorité ». Depuis 1945, ce principe pose que les mineurs doivent être punis moins sévèrement que les adultes, ce qui se traduit par une division par deux des peines inscrites dans le Code pénal. Néanmoins, il est possible pour un juge de ne pas appliquer cette clémence pour un mineur de plus de 16 ans en tenant compte de sa « personnalité » et de sa « situation », bien que cette option ait été rarement utilisée.
La nouvelle proposition de loi ne prévoit pas de changer ce principe pour les moins de 16 ans. Pour ceux qui sont plus âgés, elle propose que l’atténuation de la peine ne soit plus automatique en cas de faits graves ou de récidive, sauf décision motivée du juge. Cela viserait des crimes comme les atteintes volontaires à la vie, les violences graves ou les agressions sexuelles. « La règle s’inverse: c’est désormais le maintien de la clémence qui doit être justifié », comme le résume l’exposé des motifs.
Ce changement suscite des controverses parmi les magistrats. Le collectif « Justice des enfants », réunissant les organisations professionnelles de la justice et des associations pour l’enfance, pense que ce renforcement de l’excuse de minorité va à l’encontre de la Constitution et des engagements internationaux de la France.
Aggravation des sanctions envers les parents de mineurs délinquants
Les députés ont également voté pour accentuer les sanctions à l’encontre des parents de jeunes délinquants. « Il existe bien des parents débordés qu’il faut aider, mais aussi d’autres qui ne prennent pas leurs responsabilités, favorisant l’escalade de la violence », tel que décrit dans l’exposé des motifs du projet de loi.
L’article 2, par exemple, accorde au juge des enfants le pouvoir d’infliger une amende civile aux parents refusant de se rendre aux convocations pour les audiences et auditions. En plus, l’article 3 établit que les deux parents ayant l’autorité parentale seront tenus responsables des dommages causés par leur enfant, même si ce dernier ne vit que chez l’un d’entre eux. Cette disposition se contente de refléter une décision de la Cour de cassation prise le 28 juin.