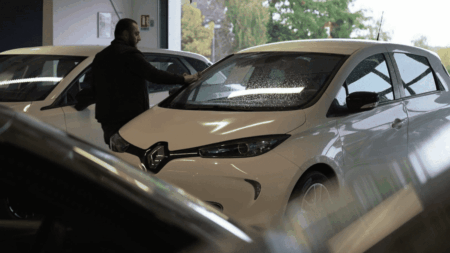Mercredi, le président des États-Unis a annoncé une nouvelle série de taxes douanières visant plusieurs pays partenaires. Ces actions sont perçues comme une intensification de la confrontation engagée par les États-Unis depuis le début de l’année.
Une opération économique massive a été lancée. C’est avec la journée dénommée « Liberation Day » que Donald Trump a levé le voile, le mercredi 2 avril, sur une nouvelle phase de sa guerre commerciale, principalement axée contre les régions d’Asie et de l’Union européenne, en instaurant des droits de douane. Depuis la Maison Blanche, le président américain a déclaré, « Notre nation a été exploité, ravagée, violée et ruinée par d’autres pays, qu’ils soient proches ou lointains, amis ou ennemis ».
Le projet de Trump inclut une nouvelle série de tarifs douaniers minimums de 10% sur l’ensemble des importations, avec des augmentations spécifiques pour les nations perçues comme commercialement hostiles. Cette initiative, visant à revitaliser le secteur manufacturier américain et à remplir les caisses de l’État fédéral, est également utilisée comme un outil diplomatique. Selon les déclarations officielles de la Maison Blanche, l’objectif est de forcer certains pays à agir contre l’immigration illégale et le trafic de Fentanyl. Ces nouvelles taxes s’ajoutent à celles déjà en place depuis janvier sur les produits en provenance de Chine, ainsi que sur l’acier, l’aluminium et certains articles mexicains et canadiens.
« Droits de douane, un levier de réciprocité »
Lors d’une interview accordée à Bloomberg en janvier, le président américain avait déclaré, « Pour moi, ‘tarif douanier’ est sans doute le mot le plus beau du dictionnaire ». Mais quel est réellement ce levier que Donald Trump admire tant ? Les droits de douane, « sont perçus lorsqu’un produit entre dans un pays. Chaque fois qu’un article franchit une frontière, il doit être déclaré, et une taxe doit être payée pour que ce produit puisse être vendu localement », explique Alexandre Maitrot de la Motte, professeur spécialisé en droit fiscal à l’université Paris-Est. Cet outil existe principalement pour « réguler le commerce », comme l’indique Arnaud de Nanteuil, professeur de droit international à la même université. L’économiste ajoute également que, « lorsqu’un État souhaite accueillir de nombreuses marchandises, il peut réduire ces taxes, et inversement, les augmenter lorsqu’il souhaite en limiter l’importation ».
Cette taxation, qui affecte directement le prix des biens importés, a une influence directe sur la demande.
« Si vous êtes un acheteur américain et que vous choisissez une voiture fabriquée aux États-Unis, vous ne payerez pas de tarif douanier. Cependant, si vous préférez un modèle allemand, et que le tarif sur les produits importés est de 20%, alors votre véhicule vous coûtera 20% de plus, vous déciderez alors d’opter pour un modèle américain. »
Alexandre Maitrot de la Motte, professeur de droit fiscalà 42mag.fr
Arnaud de Nanteuil précise que, « une marchandise ne peut être introduite sur le marché national qu’à la condition que la taxe ait été réglée ». Un pays fortement dépendant de ses exportations pourrait voir son économie sévèrement affectée si des droits de douane sur ses produits augmentaient.
Donald Trump ne se contente pas des droits de douane unilatéraux. Il a également recours à des tarifs douaniers réciproques. Comme il l’a expliqué pendant sa campagne, selon un rapport de l’AFP, « Œil pour œil, tarif douanier pour tarif douanier, au même montant. Si on nous impose des frais, on les impose aussi ». Pour chaque article importé aux États-Unis, les tarifs seront ajustés pour correspondre à ceux du pays d’origine, tout en prenant en compte d’éventuelles réglementations ou taxes locales, comme c’est le cas avec la TVA française.
Les répercussions possibles d’une escalade de droits de douane
Quelle serait la conséquence de cette hausse de tarifs douaniers ? Les États-Unis se lancent dans une bataille commerciale, soit « un conflit entre nations utilisant des outils économiques pour soutenir leur propre économie », selon Arnaud de Nanteuil. Ce bras de fer repose sur la décision d’un pays d’augmenter unilatéralement les taxes sur les biens étrangers, afin de protéger son industrie locale. Sous l’administration Trump, il s’agit d’encourager la production locale, de ramener les industries délocalisées et d’améliorer la compétitivité américaine. Selon les données de 2024 du bureau du représentant américain au commerce, le pays présentait un déficit commercial de 235 milliards de dollars avec l’Union européenne.
Arnaud de Nanteuil rappelle que les relations commerciales entre pays ont toujours été ponctuées de variations tarifaires. Toutefois, la guerre commerciale de Donald Trump pourrait « paralyser l’importation de certains produits ». Il note que, « alors que les tarifs douaniers tournent généralement autour de 4 à 5%, les faire passer à 25% est immense ».
Un autre danger est celui d’un « effet cascade ». L’Union européenne, « prête pour la guerre commerciale » face aux États-Unis, envisage comme réponse, « une offensive contre les services numériques » américains, a déclaré jeudi Sophie Primas, la porte-parole gouvernementale française, à la station RTL. Une nouvelle série de tarifs douaniers a été annoncée par l’UE « d’ici fin avril ». « Chaque pays risque d’augmenter ses droits, rendant l’accès aux produits étrangers de plus en plus cher », soutient Alexandre Maitrot de la Motte. Cela pourrait entraîner « Des milliards de dollars de produits stagnants aux frontières, des entreprises incapables d’exporter et des investisseurs découragés », souligne Arnaud de Nanteuil.
« À long terme, cette guerre commerciale entraînera des conséquences négatives considérables, car la hausse des tarifs douaniers bride le commerce mondial. »
Alexandre Maitrot de la Motte, professeur de droit fiscalà 42mag.fr
Cette politique protectionniste affectera aussi le consommateur. Selon une étude du Budget Lab de l’université de Yale, publiée en mars, les tarifs imposés par Trump pourraient coûter entre 1 600 et 2 000 dollars par an aux ménages américains.
Se diriger vers une nouvelle organisation du commerce mondial
Des spécialistes préviennent que ces tarifs douaniers réciproques pourraient implicitement mettre fin à une règle centrale du commerce mondial, basée sur le principe de non-discrimination entre pays développés et en développement. « Donald Trump exige un effort identique de tous. C’est un choix politique fort, qui va à l’encontre du soutien au développement », évalue Arnaud de Nanteuil.
Pour Sébastien Jean, professeur d’économie au CNAM et directeur associé à Ifri, cette approche protectionniste équivaut à « quitter de fait l’OMC » et représentera « une rupture des engagements américains fondamentaux » envers l’organisation, qui a pour objectif d’empêcher que chaque pays n’agisse pour son propre compte. La perspective de Donald Trump privilégie une vision unilatérale, « c’est la loi du plus fort et il invite les autres à établir leurs propres limites. C’est un moyen pour les États-Unis de mettre fin au multilatéralisme, » ajoute Alexandre Maitrot de la Motte.
Pour atténuer l’impact des nouveaux tarifs, le Vietnam a déjà annoncé réduire ses tarifs douaniers. Certains pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud cherchent maintenant à accélérer leurs discussions pour arriver à un accord de libre-échange. Alexandre Maitrot de la Motte voit en cette démarche une opportunité et suggère de renforcer les partenariats à l’international. « Les Européens seraient avisés de signer, même symboliquement, un accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique, pour donner priorité à leurs biens », conclut-il.