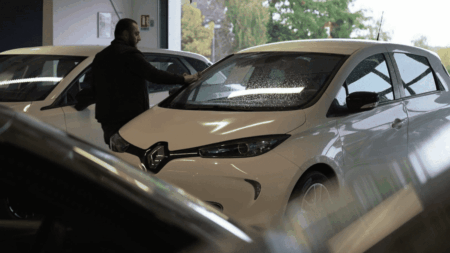Entre 1956 et 1973, le boulevard périphérique de Paris a vu le jour, majoritairement édifié sur l’emplacement des anciennes fortifications de Thiers, depuis longtemps délaissées par les forces militaires. Peut-on cependant considérer qu’il durera indéfiniment ?
À partir du 1er octobre, Anne Hidalgo a pris la décision de réduire la vitesse sur le périphérique à 50 km/h. Cependant, cette artère constamment congestionnée est-elle vouée à rester une simple ceinture autour de la ville ? Les périphériques, rocades ou encore « tangentielles » sont en réalité des autoroutes urbaines bruyantes et polluées, construites dans les années 1960 pour désencombrer les centres-ville. Que peut-on dire aujourd’hui de ces infrastructures ?
Un mur entre centre et banlieue, l’échec de la fluidité
Le mot « rocade » trouve son origine dans le jargon militaire, désignant au XVIIIe siècle une route construite en parallèle du front, à l’arrière des lignes ennemies. Cela n’est peut-être pas anodin que le périphérique parisien ait été édifié sur le tracé d’anciennes fortifications destinées à défendre contre des incursions extérieures. En effet, les périphériques et rocades semblent avoir pour fonction de maintenir à distance des grandes villes ceux qui n’y résident pas.
Concernant la circulation, aucune rocade en France n’a réussi à résoudre le problème des embouteillages. Les habitants de Paris, Bordeaux et Lyon perdent en moyenne cinq jours par an immobilisés dans les bouchons.
Après environ 50 ans d’existence, il est temps de faire le point et peut-être de réinventer ces axes routiers. Pour l’instant, la tendance générale est à la réduction de la vitesse. À Toulouse, la vitesse est passée de 110 km/h à 90 km/h, à Lyon de 90 km/h à 70 km/h, et elle va bientôt être réduite à 50 km/h à Paris. Bien que cela semble être une perte de temps considérable, la différence n’est en réalité que de quelques minutes. Ralentir pourrait être le début de la transformation de ces routes dans un monde en plein changement.